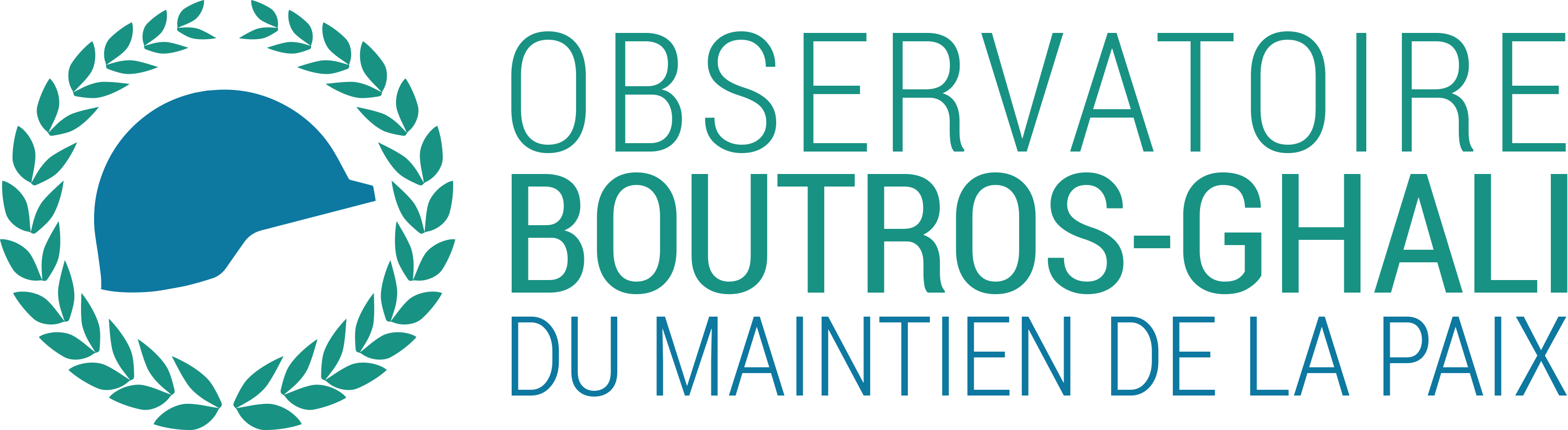Peter Albrecht et al., « Reimagining peacekeeping in Africa and beyond », Danish Institute for International Studies, 3 mai 2024.
Peter Albrecht et al., « Reimagining peacekeeping in Africa and beyond », Danish Institute for International Studies, 3 mai 2024.
Dans cet article du Danish Institute for International Studies, un ensemble de chercheurs travaillant sur le maintien de la paix, plaident pour une réinvention du maintien de la paix en Afrique. Les auteurs commencent par rappeler la nécessité d’une réévaluation complète des pratiques du maintien de la paix. En effet, Il est de plus en plus admis que les opérations multidimensionnelles des Nations unies n’ont pas atteint les objectifs fixés, à savoir l’instauration d’une paix équitable et durable là où elles ont été déployées. Les auteurs mettent notamment en avant les écarts importants entre les attentes et les réalités sur le terrain dus à l’élargissement des mandats des missions de maintien de la paix pour s’adapter à la complexité croissante des crises.
Les tensions entre les membres du Conseil de sécurité des Nations unies constituent également des obstacles importants à l’innovation dans le maintien de la paix. Cela a notamment engendré l’accroissement de l’implication des organisations régionales dans le maintien de la paix ainsi que la création de missions ad hoc pour la résolution des conflits, comme la force conjointe du G5 Sahel. De manière générale, le maintien de la paix, qui auparavant se traduisait par des opérations multilatérales à long terme menées par les Nations unies avec des objectifs généraux, est aujourd’hui porté par des missions de réaction rapide à court terme visant à lutter contre le terrorisme ou les insurrections. Bien que ces missions soient plus agiles et flexibles, contrairement aux OP onusiennes traditionnelles, elles comportent également d’importants défis, en termes d’intérêts personnels des États engagés, de durabilité (les ressources manquent souvent) et de coordination.
Les auteurs concluent que cette transition vers des stratégies plus régionales nécessite une réévaluation profonde des principes fondamentaux qui ont guidé le maintien de la paix au cours des dernières décennies, il faut un recalibrage de ce qui constitue un maintien de la paix efficace. Les auteurs appellent notamment à la mise en place à des stratégies non seulement novatrices, mais aussi plus systématiquement enracinées dans les réalités des régions touchées par les conflits. Par exemple, si l’accent mis sur le leadership de l’Union africaine (UA) a été jusqu’à présent plus rhétorique que fondé sur des pratiques réelles, les États membres de l’UA doivent jouer leur rôle, sur les plans politique et stratégique, afin de façonner les initiatives de maintien de la paix en conséquence.
Ismene Gizelis et Louise Olsson, « What Has Peacekeeping Ever Done for Us? », PRIO Blogs, 1er mars 2024.
Ismene Gizelis et Louise Olsson, « What Has Peacekeeping Ever Done for Us? », PRIO Blogs, 1er mars 2024.
Dans cet article de PRIO, Ismene Gizelis et Louise Olsson, respectivement professeure à l’université d’Essex et chercheuse au PRIO, soutiennent l’idée selon laquelle même si les opérations de maintien de la paix des Nations unies ne sont pas toujours couronnées de succès, elles produisent en revanche des externalités positives au-delà de la réduction de la violence. Les autrices avancent notamment que les opérations de maintien de la paix peuvent empêcher la reprise des conflits, limiter la violence contre les civils et favoriser la réconciliation. Cet article s’inscrit dans le cadre du projet Peace Dividends ayant pour objectif d’étudier les avantages du maintien de la paix, de la reconstruction post-conflit et du renforcement de l’État.
Les autrices argumentent que les opérations peuvent jouer un rôle central dans le soutien des réformes menées par l’État dans le cadre d’accords de paix ou dans l’établissement d’un nouveau contrat social. De manière générale, le travail de synergie entre les réformes de l’Etat et les opérations de maintien de la paix peut amener à des avancées majeures dans les efforts internes de développement. En particulier, cette synergie peut avoir des effets positifs sur les résultats du développement tels que la santé, l’éducation et l’autonomisation des femmes.
En conséquence, les autrices prônent une redéfinition des objectifs de sécurité des opérations de maintien de la paix afin d’adopter une approche ambitieuse et globale de la reconstruction post-conflit. Cela permettrait de pleinement utiliser le maintien de la paix comme un outil limitant les conséquences dévastatrices de la guerre. Les autrices formulent également une matrice d’indicateurs pour évaluer le travail des opérations de maintien de la paix. Elle se compose de trois critères : le développement humain, l’inclusion politique et l’égalité des genres, et la capacité de l’État en termes de fiscalité et de finances publiques. Selon les autrices, en analysant l’évolution de ces trois dimensions, il est possible d’évaluer quelles politiques de maintien de la paix sont plus (ou moins) efficaces et comprendre comment les institutions – et par extension le développement – peuvent croître au sein de contextes post-conflit. Enfin, les autrices soulignent l’importance d’adopter une approche inclusive à l’égard des femmes dans la construction de la paix.
Cédric de Coning, “How Not to Do UN Peacekeeping’’, International Peace Institute, 17 mai 2023.
Cédric de Coning, “How Not to Do UN Peacekeeping’’, International Peace Institute, 17 mai 2023.
- Cédric de Coning, “How Not to Do UN Peacekeeping’’, International Peace Institute, 17 mai 2023. Dans cet article de l’International Peace Institute, Cédric de Coning, enseignant-chercheur au Norwegian Institute of International Affairs(NUPI) et conseiller principal au Centre africain pour la résolution constructive des conflits (ACCORD), fait le bilan des 75 ans de maintien de la paix des Nations unies et analyse les difficultés auxquelles sont confrontées les opérations de maintien de la paix (OMP) aujourd’hui. L’auteur part d’abord du constat que les trois grandes opérations de stabilisation de l’ONU (MINUSMA, MINUSCA, MONUSCO) ont perdu la confiance des pays dans lesquels elles sont déployées. Ce constat est confirmé par le fait que depuis 2014, seules des missions politiques spéciales ont été déployées, alors que les OMP sont considérées comme inefficaces face à la dégradation de la situation sécuritaire sur ces terrains. Cédric de Coning explique que l’échec perçu de ces missions, désignées comme des missions de stabilisation, s’explique notamment par le fait qu’elles opèrent dans des contextes de conflits où tout processus politique ou de paix viable est absent. Elles cherchent donc à restaurer l’autorité et les capacités de l’État plutôt qu’à mettre en œuvre un cessez-le-feu ou un accord de paix, comme le feraient des missions dites de maintien de la paix. Cette approche est problématique à différents égards. D’abord, l’impartialité des opérations de stabilisation peut être questionnée, puisque ces missions se placent en soutien à un État souvent contesté. De plus, leur mandat autorise l’usage de la force non seulement pour la protection des civils, mais aussi pour neutraliser des groupes armés, comme c’est le cas du M23 en RDC. L’auteur évoque aussi le dilemme de stabilisation qu’entraîne ce type de missions. Plus une opération de paix est efficace pour protéger les civils et stabiliser le pays, moins l’État hôte est incité à trouver des solutions politiques de long terme qui permettront ensuite le départ de la mission. Ce dilemme conduit ainsi à une prolongation des conflits, à une perte de crédibilité et de confiance envers le maintien de la paix onusien et à un déclin de son utilisation. Cédric de Coning conclut donc que le Conseil de sécurité ne doit déployer ce type de missions que s’il existe un accord de cessez-le-feu, de paix ou un processus politique viable, seuls cas dans lesquels les OMP peuvent être efficaces. Si ces conditions ne sont pas réunies, le Conseil de sécurité doit prioriser d’autres solutions pour rétablir la paix, se tourner vers des coalitions de volontaires ou collaborer avec l’Union africaine lorsqu’il est nécessaire d’imposer la paix.
Jenna Russo, “75 Years On, the Uncertain Fate of UN Peacekeeping”, International Peace Institute, 16 mai 2023.
Jenna Russo, “75 Years On, the Uncertain Fate of UN Peacekeeping”, International Peace Institute, 16 mai 2023.
- Jenna Russo, “75 Years On, the Uncertain Fate of UN Peacekeeping”, International Peace Institute, 16 mai 2023. À l’occasion des 75 ans du maintien de la paix, Jenna Russo, Directrice de la recherche et cheffe du Centre Brian Urquhart pour les opérations de paix au sein de l’International Peace Institute, se penche sur les défis auxquels le maintien de la paix est confronté au niveau international, institutionnel et sur le terrain. Au niveau international d’abord, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a aggravé les tensions déjà importantes au sein du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) ce qui a notamment conduit à réduire le nombre de résolutions adoptées ainsi que la capacité à avoir l’unanimité, ce qui affaiblit la légitimité des mandats. Ces tensions limitent également la capacité du CSNU à répondre de manière flexible aux situations de crises émergentes. Au niveau institutionnel ensuite, l’ONU est en train de repenser la façon dont elle conçoit le maintien de la paix. En 2022, les opérations de maintien de la paix ont connu des crises de consentement, tant avec les gouvernements hôtes qu’avec les populations locales. Jenna Russo souligne également que le maintien de la paix est presqu’absent du rapport « Notre programme commun » du Secrétaire général, ce qui est peut-être le signe que la prévention et la consolidation de la paix vont être priorisées par rapport au maintien de la paix.
Les défis du maintien de la paix se situent également au niveau national, où le contexte sécuritaire s’est détérioré, avec une violence croissante contre les soldats de la paix et une montée de l’extrémisme violent. Avec les menaces toujours plus fortes posées par les groupes terroristes, certains États attendent une réponse plus assertive, assumée parfois par des coalitions régionales, sous-régionales ou multinationales mais dans d’autres situations certains États se tournent vers des mercenaires ou des sociétés militaires privées. Enfin, Jenna Russo note plusieurs opportunités d’amélioration pour l’avenir :
- Élaborer des mandats plus flexibles, réalistes et appropriés aux ressources de l’ONU
- Renforcer davantage les partenariats avec les organisations régionales et sous-régionales
- Remettre en question les approches trop centrées sur la consolidation de l’État et la stabilisation qui conduisent souvent à des réponses militarisées incapables de traiter les racines profondes du conflit
L’autrice termine tout de même en précisant que les Nations unies restent le meilleur acteur pour maintenir la paix et la sécurité, et que le maintien de la paix est l’un de ses outils les plus puissants pour y parvenir.
Julia Gregory, “Sharing the Pen in the UN Security Council: A Win for Inclusive Multilateralism?”, IPI, 7 avril 2023.
Julia Gregory, “Sharing the Pen in the UN Security Council: A Win for Inclusive Multilateralism?”, IPI, 7 avril 2023.
- Julia Gregory, “Sharing the Pen in the UN Security Council: A Win for Inclusive Multilateralism?”, IPI, 7 avril 2023. Dans cet article de l’International Peace Institute, Julia Gregory s’intéresse à l’enjeu des porteurs de plume au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et son impact potentiel sur le multilatéralisme. En 2022 les dix membres élus (E10) du CSNU ont appelé à une plus grande diversification des porteurs de plume. Julia Gregory souligne que depuis 2003 la France, le Royaume-Uni et les États-Unis (P3) tous membres permanents tiennent ce rôle en grande majorité, certains parlent ainsi de « monopole de fait » sur les résultats du CSNU. Elle rappelle que tenir la plume sur un dossier nécessite non seulement une motivation politique mais aussi une capacité opérationnelle, notamment en termes d’experts mobilisables, pour les nouveaux membres élus. De plus, la majorité des sujets pertinents sont souvent déjà cooptés au sein du CSNU. Ensuite, Julia Gregory aborde le sujet du partage de plume, pratique de plus en plus courante au sein du CSNU depuis 2018. Les co-porteurs doivent s’assurer de leur valeur ajoutée mutuelle sur le dossier et doivent pouvoir s’accorder sur un ensemble d’objectifs et de priorités afin que le processus reste fluide et efficace. La codirection avec des membres non permanents a plusieurs avantages, ces derniers peuvent bénéficier d’une visibilité et d’une reconnaissance internationales accrues, tandis que les membres permanents peuvent profiter de l’énergie nouvelle, de la perspective et des relations diplomatiques qu’un membre élu peut apporter. L’autrice conclut en soulignant qu’un plus grand partage de la plume pourrait à terme permettre une plus grande union du CSNU ainsi que lancer les bases d’une réforme de ce derniers tout en répondant aux préoccupations exprimées par les E10, ainsi que par plusieurs États hôtes de missions de maintien de la paix. Les membres africains élus (collectivement appelés « A3 ») ont exprimé leur volonté de voir plus de résultats adaptés aux contextes africains. Julia Gregory rappelle qu’aujourd’hui la France et le Royaume-Uni dirigent tous deux l’action du Conseil sur leurs anciennes colonies. De plus, on voit de plus en plus d’États hôtes de missions de paix onusiennes critiquer voire s’opposer aux pratiques des détenteurs de plume, comme ce fut le cas pour le Mali qui en mars 2023 a soumis une lettre au président du Conseil de sécurité rejetant la France comme porte-plume sur toutes les questions concernant le Mali. L’autrice insiste sur le fait que les A3 pourraient avoir un impact positif en co-porteurs de plume là où ils jouent déjà un rôle régional, à condition qu’ils puissent servir de modérateurs impartiaux, elle donne l’exemple du Ghana au Sahel.
Sara Hellmüller, Xiang-Yun Rosalind Tan et Corinne Bara, “What is in a Mandate? Introducing the UN Peace Mission Mandates Dataset’’, Journal of Conflict Resolution, 2 mars 2023.
Sara Hellmüller, Xiang-Yun Rosalind Tan et Corinne Bara, “What is in a Mandate? Introducing the UN Peace Mission Mandates Dataset’’, Journal of Conflict Resolution, 2 mars 2023.
- Sara Hellmüller, Xiang-Yun Rosalind Tan et Corinne Bara, “What is in a Mandate? Introducing the UN Peace Mission Mandates Dataset’’, Journal of Conflict Resolution, 2 mars 2023.Dans cet article du Journal of Conflict Resolution, Sara Hellmüller, professeure assistante au FNS ; Xiang-Yun Rosalind Tan, doctorante en affaires internationales à l’IHEID ; et Corinne Bara, professeure assistante au département de recherche sur la paix et les conflits de l’université d’Uppsala, font le constat que les missions de paix onusiennes ont beaucoup évolué depuis la Guerre froide. Les autrices relèvent notamment que les missions politiques prennent peu à peu le pas sur les missions plus larges de maintien de la paix, et que ces dernières mettent en place de plus en plus de mesures coercitives pour assurer la sécurité et la protection des civils. Mais elles remarquent que malgré ces tendances, il est difficile d’appréhender les logiques de modification du type ou des objectifs de missions de paix dans le temps, du fait d’une catégorisation trop restrictive du type de missions dans les statistiques, qui distinguent, par exemple, les missions d’observation, les missions traditionnelles, les missions multidimensionnelles et les missions d’imposition de la paix. Afin de combler cette lacune l’article présente une nouvelle base de données relatives aux mandats des missions de paix de l’ONU (UNPMM) dans le monde entier. L’UNPMM regroupe les données les plus détaillées et les plus récentes à ce jour provenant de 113 missions de paix mises en place sur une période s’étalant de 1991 à 2020 et détaillant 41 différents types de fonctions que peuvent comprendre les mandats. L’UNPMM contribue à étudier les évolutions des missions de paix de l’ONU en analysant non seulement des opérations de maintien de la paix, mais aussi des missions politiques spéciales et des missions des envoyés spéciaux de l’ONU, tout en présentant une nouvelle catégorisation qui distingue les missions selon le type de leurs objectifs, à savoir : minimalistes, modérés ou maximalistes. L’article présente les avantages comparatifs de l’UNPMM avant d’explorer les grandes tendances qui ressortent de l’analyse des données au niveau des types de missions, des objectifs et des tâches spécifiques des mandats. Enfin, il démontre le potentiel de l’UNPMM à l’aide d’une analyse statistique. L’article se conclut en expliquant que l’UNPMM apporte les données nécessaires pour permettre de comprendre depuis différents angles d’approche la nature évolutive des missions de paix onusiennes. Les autrices démontrent ainsi qu’il est primordial de décomposer les données relatives aux missions de paix et à leurs mandats, afin d’en saisir toutes les nuances, notamment en ce qui concerne leur efficacité. Cette nouvelle base de données permet également de contribuer à la recherche sur les missions de paix de trois façons :
- en examinant les facteurs qui peuvent influencer les mandats de missions de paix de l’ONU,
- en explorant de nouvelles façons de mesurer l’efficacité des missions au travers de l’analyse des tâches spécifiques des mandats,
- et en examinant l’adaptabilité et l’implémentation de ces tâches sur le terrain, permettant de contribuer à la recherche sur les interactions locales-globales.
Albert Trithart, “Disinformation against UN peacekeeping operations”, IPI, 4 novembre 2022.
Albert Trithart, “Disinformation against UN peacekeeping operations”, IPI, 4 novembre 2022.
Dans cette publication de l’International Peace Institute de novembre 2022, Albert Trithart s’intéresse à la désinformation visant spécifiquement les missions de paix de l’ONU. Celles-ci font face à des campagnes de désinformation les accusant de participer au trafic d’armes, de fournir des armes aux groupes terroristes, de les soutenir ou bien encore d’exploiter les ressources naturelles des pays dans lesquels elles sont implantées. Cette désinformation a pour conséquence de mettre en danger les soldats du maintien de la paix et de nuire à l’efficacité des missions. Les principales missions touchées sont la MINUSCA, la MINUSMA et la MONUSCO. L’auteur souligne que la dynamique qui sous-tend ces campagnes de désinformation diffère d’un pays à l’autre mais qu’il existe plusieurs facteurs communs qu’on retrouve en RDC, au Mali et en RCA : la frustration, la colère, la peur face à une situation sécuritaire instable et l’échec perçu des missions de maintien de la paix. C’est ce ressentiment envers les missions de paix qui créé une crise de légitimité et une situation favorable à la propagation de fausses informations à leur égard. Au siège et sur le terrain, le personnel de l’ONU tente d’intensifier ses efforts pour lutter contre la désinformation. Depuis juin 2022, la politique de communication stratégique du Département des opérations de paix de l’ONU met en œuvre un axe de travail basé spécifiquement sur la lutte contre la désinformation. Sur le terrain, La MINUSCA, la MINUSMA et la MONUSCO ont toutes pour mandat d’aborder et de rendre compte de la désinformation. L’auteur explique qu’une lutte préventive contre la désinformation permettrait, d’une part d’améliorer la sécurité du personnel sur le terrain, et d’autre part, d’aider à la création d’un climat politique plus sain. Pour autant la désinformation reste le symptôme de problèmes plus graves liés à la géopolitique régionale et internationale, et à la relation entre la mission, l’état hôte et les populations. Trithart propose une série de questions cadre que les missions et le DOP devraient se poser lors de l’élaboration des politiques, directives, structures et activités de lutte contre la désinformation : – Comment les missions peuvent elles développer une approche stratégique et transversale de la désinformation ? – Comment les missions peuvent elles mieux surveiller et analyser la désinformation en ligne et dans les médias plus ‘classiques’ ? – Comment les missions peuvent elles répondre plus rapidement à la désinformation ? – Comment les missions peuvent elles transformer les récits anti ONU ? – Comment les missions peuvent elles contribuer à un environnement informationnel plus sain ? – L’ampleur du problème exige-t-elle un changement d’approche plus décisif ?
Vanessa F.Newby, “Offering the Carrot and Hiding the Stick? Conceptualizing Credibility in UN Peacekeeping”, Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, 19 septembre 2022.
Vanessa F.Newby, “Offering the Carrot and Hiding the Stick? Conceptualizing Credibility in UN Peacekeeping”, Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, 19 septembre 2022.
- Vanessa F.Newby, “Offering the Carrot and Hiding the Stick? Conceptualizing Credibility in UN Peacekeeping”, Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, 19 septembre 2022. Dans cet article, Vanessa F. Newby, chercheure à l’Université de Leiden, interroge le concept de crédibilité dans le maintien de la paix. Par crédibilité dans le maintien de la paix, l’autrice entend « la croyance des parties prenantes dans la capacité et la volonté (résolution) d’une opération de paix de tenir ses engagements ». Elle pose les questions suivantes : qu’est-ce qui donne la crédibilité à une force de maintien de la paix ? Et si une force du maintien de la paix est crédible, à quoi sert-elle ? Quels sont ses buts ? Et qui vise-t-elle ? L’autrice soutient la thèse que la crédibilité d’une opération de maintien de la paix repose sur deux facteurs : (1) la dissuasion, définit comme l’aptitude à dissuader d’utiliser la violence lors d’une situation conflictuelle et (2) la capacité à coopérer (“cooperativeness” en anglais) entendue comme ce qui permet de cultiver la coopération des publics nationaux et sous-nationaux dans le cadre d’une OP. Selon elle, ces deux concepts sont des éléments essentiels d’une opération de paix. Toutefois, elle questionne leur compatibilité et constate la contradiction inhérente entre ces deux objectifs. Il semble se dégager de la réflexion de l’autrice que la capacité à coopérer est l’opérateur à privilégier. Le concept de crédibilité bien que présent dans l’analyse des opérations de paix et l’étude de leur succès reste encore peu étudié, ce qui fait la singularité de ce texte. Enfin, au-delà d’une réflexion conceptuelle, ce texte offre aux praticiens des opérations de maintien de la paix des modèles leur permettant de jauger la nature et la force de la crédibilité dans leurs missions
Anjali Danjal « A Crisis of Consent in UN Peace Operations », The Global Observatory, août 2022.
Anjali Danjal « A Crisis of Consent in UN Peace Operations », The Global Observatory, août 2022.
- Anjali Danjal « A Crisis of Consent in UN Peace Operations », The Global Observatory, août 2022. Dans cette note d’analyse, Anjali Dayal, professeure adjointe de politique internationale au département des sciences politiques de l’université Fordham, à New York, s’intéresse à la crise de consentement à laquelle sont confrontées les missions de maintien de la paix de l’ONU. Elle s’appuie en particulier sur les périodes de turbulences récentes de la MONUSCO et de la MINUSMA suite à l’effritement du consentement de l’Etat hôte et d’importantes manifestations civiles. Anjali Dayal met en lumière le besoin de reconfigurer les opérations de maintien de la paix afin qu’elles puissent mieux s’adapter aux exigences du terrain. L’objectif est d’assurer efficacement la protection des civils, mais également des contingents eux-mêmes. Anjali Dayal expose les deux composantes structurelles de la notion de consentement, l’un des principes préalables à la mise en place d’une opération de maintien de la paix. Premièrement, l’autrice rappelle que l’appareil étatique doit consentir à l’accueil des forces onusiennes, du fait de défaillances logistiques au niveau des services de sécurité. Elle rappelle que de ce fait les contingents onusiens ont une posture défensive en faveur d’une structure étatique qui lutte contre des groupes armés. Deuxièmement, la présence onusienne doit être acceptée par la population qui malgré les contingents déployés continue la plupart du temps à subir des exactions. Hors, une mission de maintien de la paix tournée vers les besoins sécuritaires de l’État crée un sentiment de distance avec les civils mettant en péril une paix précaire. In fine, l’autrice évoque l’importance d’obtenir le consentement tant de l’Etat que de la population. Pour ce faire, l’ONU dispose d’outils et de techniques pour encourager les efforts de consolidation de la paix au niveau local. Le fait de centrer ces outils et techniques sur l’établissement d’un consensus et d’un consentement autour de la présence de l’ONU dans les communautés locales devrait être un élément clé de chaque mission.
Christoph Harig, Nicole Jenne, “ Whose rules? Whose power? The Global South and the possibility to shape international peacekeeping norms through leadership appointments”, Cambridge University Press, juin 2022.
Christoph Harig, Nicole Jenne, “ Whose rules? Whose power? The Global South and the possibility to shape international peacekeeping norms through leadership appointments”, Cambridge University Press, juin 2022.
- Christoph Harig, Nicole Jenne, “ Whose rules? Whose power? The Global South and the possibility to shape international peacekeeping norms through leadership appointments”, Cambridge University Press, juin 2022. Dans cet article Christoph Harig et Nicole Jenne analysent la manière dont les États du Sud peuvent influencer la mise en œuvre des normes sur le maintien de la paix à travers les nominations de dirigeants au sein des Nations unies. Pour cela, ils ont analysé le comportement des dirigeants par rapport aux préférences de politiques étrangères de leurs pays d’origine, en se focalisant sur le cas des commandants des forces militaires du Brésil, de l’Inde et du Rwanda. Ils soutiennent que les organisations internationales, dont les Nations unies, reflètent les configurations et les inégalités du pouvoir mondial. La surreprésentation des États du Nord aux postes exécutifs et de haut rang leur permet de façonner le processus décisionnel et les normes de gouvernance mondiale. Au contraire, le maintien de la paix des Nations unies offre une opportunité pour les États exclus de l’élaboration des normes de contester leur mise en œuvre. En effet, depuis les deux dernières décennies, le maintien de la paix est devenu plus coercitif. Les pays du Nord financent la majorité du maintien de la paix lorsque les pays du Sud sont les États qui contribuent à la majorité des troupes. Ainsi, par leur contribution, ils peuvent exiger une reconnaissance sous la forme de poste de direction, qui peuvent fournir une plus grande marge de manœuvre. Finalement, les auteurs soulignent que les pratiques des commandants de forces au regard de la position politique de leur pays d’origine étaient variables. Alors que dans le cas de l’Inde et du Rwanda, les dirigeants agissent selon les préférences de leur pays, les dirigeants du Brésil, au contraire, procèdent selon leur propre opinion. Ainsi, ils considèrent qu’une variété de facteurs influencent le rôle que jouent les dirigeants dans la mise en œuvre des normes internationales, des différences qui s’expliquent notamment en fonction des conditions de vie dans le pays hôte, des relations entre les civils et les militaires et du contexte dans lequel évoluent les forces armées dans le maintien de la paix.
Nina Wilén, « From « Peacekept » to « Peacekeeper »: Seeking International Status by Narrating New identities », Journal of Global Security Studies, Mai 2022.
Nina Wilén, « From « Peacekept » to « Peacekeeper »: Seeking International Status by Narrating New identities », Journal of Global Security Studies, Mai 2022.
- Nina Wilén, « From « Peacekept » to « Peacekeeper »: Seeking International Status by Narrating New identities », Journal of Global Security Studies, Mai 2022. Nina Wilén a publié un article portant sur la manière dont les pays en situation de post-conflit contributeurs de troupes (PCTCC) tentent de faire évoluer leur statut international en transformant leur identité de « Peacekept » à « Peacekeeper » – c’est-à-dire en passant d’un statut de bénéficiaire d’une OP à celui de contributeur au maintien de la paix.. Comparant les parcours de deux PCTCC (le Burundi et le Rwanda), elle analyse les discours officiels à travers un cadre théorique qui combine la théorie de l’identité sociale et les approches narratives. Elle soutient que les PCTCC cherchent un statut et une nouvelle identité à travers la contribution au maintien de la paix, notamment pour mettre en avant leur souveraineté, mais également protéger leurs affaires intérieures de toute interférence. Néanmoins, pour réussir à obtenir ce statut, les récits doivent être cohérents et être co-constitués par d’autres acteurs internationaux.Finalement, elle affirme que plusieurs PCTCC se sont également créé une nouvelle identité par leur participation au maintien de la paix, avec parfois des tendances autoritaires, mais aussi dans un environnement politique démocratique comme la Sierra Leone. Une construction qui ne se limite pas aux États africains puisque d’autres pays tels que le Népal utilisent aussi ce statut comme levier sur la scène internationale.
Novosseloff Alexandra, « A Comparative study of older one-dimensional UN Peace Operations : Is the Future of UN Peacekeeping its Past ? », EPON, April 2022.
Novosseloff Alexandra, « A Comparative study of older one-dimensional UN Peace Operations : Is the Future of UN Peacekeeping its Past ? », EPON, April 2022.
- Novosseloff Alexandra, « A Comparative study of older one-dimensional UN Peace Operations : Is the Future of UN Peacekeeping its Past ? », EPON, April 2022. Alexandra Novosselof rappelle que la Force de maintien de la paix des Nations unies à Chypre (UNFICYP) est un modèle de mission d’observation établie pour la première fois lors de la guerre froide. 5 des 12 opérations de maintien de la paix actuellement déployées trouvent leur origine à cette période, dans un contexte de rivalités au sein du Conseil de sécurité qui limitait le maintien de la paix de l’ONU à des missions de surveillance du cessez-le-feu et d’observations des conflits interétatiques. La similarité du contexte actuel amène donc l’autrice à examiner les caractéristiques communes de ce type de missions, puisqu’elles semblent être de nouveau privilégiées par le Conseil de sécurité (aucune nouvelle mission multidimensionnelle n’a été déployée depuis 2014). Ces missions, qu’elle qualifie « d’unidimensionnelles », ont un mandat limité à la gestion d’un conflit et non à sa résolution contrairement à des missions multidimensionnelles. Elles ont été mises en œuvre alors qu’un ou plusieurs membres permanents du Conseil de sécurité avaient un intérêt direct dans le résultat. Elles ont souvent permis de contenir les conflits en adaptant et en convenant des mécanismes visant à désamorcer les tensions, bien qu’elles ne permettent pas un rétablissement de la paix – sinon la protection des statu quo. Elles peuvent cependant être vues comme un mécanisme d’alerte précoce et participer à prévenir les conflits. Pour Novosselof, il est donc peut-être temps d’accorder plus d’attention aux forces interpositionnelles et aux missions d’observations. Affichant son désaccord avec le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, elle soutient qu’aucun type de mission, aussi bien unidimensionnelle, multidimensionnelle qu’une mission politique spéciale, ne peut répondre uniquement et parfaitement à l’ensemble des besoins.
Alexander Gilder, « The Role of UN Peace Operations in Countering Health Insecurity after COVID-19 », Policy Insight, janvier 2022.
Alexander Gilder, « The Role of UN Peace Operations in Countering Health Insecurity after COVID-19 », Policy Insight, janvier 2022.
- Alexander Gilder, « The Role of UN Peace Operations in Countering Health Insecurity after COVID-19 », Policy Insight, janvier 2022. Dans un contexte international marqué par la crise de la Covid-19, Alexander Gilder propose une analyse sur le rôle des opérations de paix (OP) dans la lutte contre l’insécurité sanitaire. L’auteur part du constat que les missions de maintien de la paix de l’ONU sont principalement axées sur l’insécurité définie comme une menace physique. Outre la nécessité de proposer une interprétation plus élargie de la notion d’insécurité, il soutient que les opérations de paix doivent obtenir des capacités supplémentaires pour soutenir les populations locales face à la montée d’autres menaces telles que les crises sanitaires. Il constate qu’en 2015, seules trois opérations de paix (MONUSCO, MINUSTA et UNAMID) bénéficiaient d’un mandat qui les autorisait à fournir directement des soins médicaux à la population. La plupart des OP doivent se contenter de faciliter l’accès aux acteurs humanitaires qui fournissent leur propre assistance. Pour l’auteur, la coopération avec l’État hôte ne peut se limiter aux actions militaires, un élargissement du mandat des OP permettant une consolidation de la paix plus durable. Concrètement, Il affirme que les OP doivent étendre leurs opérations en permettant aux casques bleus d’apporter une assistance sanitaire directe à la population dans les zones hostiles. Le mandat des missions pourrait également inclure l’aide à la reconstruction et au renforcement des institutions de santé publique. Il estime que soutenir les populations face à des menaces diverses, telles que la menace sanitaire, permet d’amorcer une consolidation de la paix par le bas, en tenant compte des besoins locaux. Finalement, il rappelle que l’assistance sanitaire des OP ne doit pas être limitée aux périodes de crise sanitaire, mais doit permettre de prévenir d’éventuelles crises à l’avenir.
Anjali Kaushlesh Dayal, Incredible Commitments: How UN Peacekeeping Failures Shape Peace Processes, Cambridge University Press, octobre 2021.
Anjali Kaushlesh Dayal, Incredible Commitments: How UN Peacekeeping Failures Shape Peace Processes, Cambridge University Press, octobre 2021.
- Anjali Kaushlesh Dayal, Incredible Commitments: How UN Peacekeeping Failures Shape Peace Processes, Cambridge University Press, octobre 2021. Anjali Kaushlesh Dayal examine les raisons qui ont permis au maintien de la paix de continuer à exister, malgré ses premiers échecs en Somalie, au Rwanda et dans les Balkans, et comment ce constat a façonné le rôle actuel des OP et les mécanismes sous-jacents au maintien de la paix. Elle fait valoir deux clés de compréhension fondatrices : premièrement, elle soutient que le rôle central de l’ONU dans le rétablissement et le maintien de la paix dans le monde entier signifie que les interventions de l’ONU ont des conséquences structurelles – ce que fait l’ONU dans un conflit peut changer les stratégies, les résultats et les options disponibles pour les parties à la négociation dans d’autres conflits. Deuxièmement, s’appuyant sur des entretiens, des recherches d’archives et des négociations de paix retracées par les processus au Rwanda et au Guatemala, l’auteur soutient que les parties belligérantes, notamment les groupes rebelles, se tournent vers l’ONU même lorsqu’elles ont peu confiance dans la capacité des soldats de la paix à respecter les accords de paix – et même peu d’intérêt réel pour la paix – parce que sa participation aux processus de négociation offre des avantages tactiques, symboliques et post-conflit vitaux et uniques que seule l’ONU peut offrir.
Daniel Forti, « Independent Reviews of UN Peace Operations: A Study of Politics and Practice« , IPI, octobre 2021.
Daniel Forti, « Independent Reviews of UN Peace Operations: A Study of Politics and Practice« , IPI, octobre 2021.
- Daniel Forti, « Independent Reviews of UN Peace Operations: A Study of Politics and Practice« , IPI, octobre 2021. Cette publication de IPI note que les examens indépendants sont un outil de plus en plus populaire au sein des OP depuis leur création en 2017. Conçus pour évaluer rigoureusement l’orientation stratégique des OP, ce sont des processus complexes et hautement politiques. Cette publication se propose de réfléchir aux expériences des examens précédents pour améliorer leur qualité, leur impact et leur durabilité à l’avenir. Chaque examen indépendant dépend du mandat et du contexte spécifique de la mission associée, quoiqu’ils ont suivi une progression commune. L’auteur Daniel Forti révèle plusieurs dynamiques qui façonnent les expériences de l’ONU en matière d’examens indépendants : (1) L’indépendance est un concept relatif, (2) Les États membres, les fonctionnaires du Secrétariat de l’ONU et les missions ont des intérêts divers et souvent contradictoires concernant les examens, (3) Les équipes d’examen doivent continuellement trouver un équilibre entre la flexibilité méthodologique et la recherche d’une plus grande normalisation, (4) Les examens indépendants doivent surmonter leur statut d’orphelin au sein de l’ONU pour avoir un impact avoir un impact durable et rentabiliser le temps et les ressources qui y sont investis.En fin de compte, les examens indépendants se sont avérés être outils précieux mais imparfaits. Pour améliorer la conception et la pratique des examens futurs, le rapport recommande aux Nations unies et aux équipes d’examen de codifier les examens indépendants dans la politique officielle de l’ONU, consolider les meilleures pratiques, clarifier les rôles et les attentes du personnel de l’ONU détaché auprès des équipes d’examen, privilégier la diversité dans la composition de ces équipes, et établir un flux de financement dédié. Les équipes d’examen indépendantes doivent mettre l’accent sur leur transparence et leur indépendance, et systématiser l’utilisation de méthodes et d’approches de recherche diverses.
Annika Hansen et Naomi Miyashita, « UN Peacekeeping Embraces the Digital World », IPI, septembre 2021.
Annika Hansen et Naomi Miyashita, « UN Peacekeeping Embraces the Digital World », IPI, septembre 2021.
- Annika Hansen et Naomi Miyashita, « UN Peacekeeping Embraces the Digital World », IPI, septembre 2021. Dans cette publication Annika Hansen, et Naomi Miyashita reviennent ensemble sur le lancement de la Stratégie pour la transformation numérique du maintien de la paix de l’ONU annoncé en août par le Secrétaire général de l’ONU. Les deux auteures questionnent les défis que représente la mise en place d’un tel programme, interrogeant d’une part la capacité des OP à adopter les nouvelles technologies et de l’autre, la volonté au sein des missions de désormais reconnaitre l’importance des technologies numériques en tant qu’instrument majeur pour le maintien de la paix. D’une mission à l’autre, cette prise de conscience technologique varie et face à ce constat, les auteures soulignent l’importance d’élaborer des approches spécifiques aux missions, en s’appuyant sur les réalisations déjà effectuées pour faire le bilan des urgences majeures et évaluer quelle transformation numérique pourrait être bénéfique.
Systèmes d’alerte précoce et de réponse rapide: quelle mise en œuvre par les opérations de maintien de la paix de l’ONU ?
Systèmes d’alerte précoce et de réponse rapide: quelle mise en œuvre par les opérations de maintien de la paix de l’ONU ?
- Daniel Levine-Spound, « Systèmes d’alerte précoce et de réponse rapide: quelle mise en œuvre par les opérations de maintien de la paix de l’ONU ? », Center For Civilians in Conflict (CIVIC), août 2021. Au cours des cinq dernières années, le Center for Civilians in Conflict (CIVIC) a mené des recherches de terrain au sein de quatre missions (MINUSCA, MINUSMA, MONUSCO et MINUSS) portant sur les mécanismes d’alerte précoce et de réponse rapide, d’une importance capitale pour permettre aux OP de prévenir et réduire les menaces de court, moyen ou long terme à l’encontre des civils.Cette étude, menée par Daniel Levine-Spound, souligne que la réalité du terrain rend parfois extrêmement difficile la tâche d’identifier les menaces afin de planifier une réponse et la concrétiser. Face à ce constat, le rapport attire l’attention sur un certain nombre de limites et identifie différentes manières, processus, pratiques et outils nécessaires afin de renforcer les politiques et pratiques des OP en matière d’alerte précoce et de réponse rapide. Parmi elles figurent la nécessité de mettre en place un engagement efficace avec les communautés menacées tels qu’une coopération avec des organes civils de protection et d’alerte précoce, comme par exemple les réseaux d’alerte communautaire (CAN). De plus, le rapport met en avant l’importance de la mobilité, notamment pour garantir les moyens aériens nécessaires à la collecte des informations sur les menaces qui pèsent sur les civils. L’étude attire aussi l’attention sur la question du genre et sur la façon dont cette problématique doit être prise en compte à chaque étape du processus d’alerte précoce et de réponse rapide, allant de la collecte de données à l’élaboration des réponses. Force est de constater que le lien entre l’évaluation et l’analyse des menaces d’une part, et la planification et la prise de décision d’autre part, sont à améliorer au sein des OP.
Independent Reviews of UN Peace Operations: A Study of Politics and Practice
Independent Reviews of UN Peace Operations: A Study of Politics and Practice
- Daniel Forti, « Independent Reviews of UN Peace Operations: A Study of Politics and Practice« , IPI, octobre 2021. Cette publication de IPI note que les examens indépendants sont un outil de plus en plus populaire au sein des OP depuis leur création en 2017. Conçus pour évaluer rigoureusement l’orientation stratégique des OP, ce sont des processus complexes et hautement politiques. Cette publication se propose de réfléchir aux expériences des examens précédents pour améliorer leur qualité, leur impact et leur durabilité à l’avenir. Chaque examen indépendant dépend du mandat et du contexte spécifique de la mission associée, quoiqu’ils ont suivi une progression commune. L’auteur Daniel Forti révèle plusieurs dynamiques qui façonnent les expériences de l’ONU en matière d’examens indépendants : (1) L’indépendance est un concept relatif, (2) Les États membres, les fonctionnaires du Secrétariat de l’ONU et les missions ont des intérêts divers et souvent contradictoires concernant les examens, (3) Les équipes d’examen doivent continuellement trouver un équilibre entre la flexibilité méthodologique et la recherche d’une plus grande normalisation, (4) Les examens indépendants doivent surmonter leur statut d’orphelin au sein de l’ONU pour avoir un impact avoir un impact durable et rentabiliser le temps et les ressources qui y sont investis.En fin de compte, les examens indépendants se sont avérés être outils précieux mais imparfaits. Pour améliorer la conception et la pratique des examens futurs, le rapport recommande aux Nations unies et aux équipes d’examen de codifier les examens indépendants dans la politique officielle de l’ONU, consolider les meilleures pratiques, clarifier les rôles et les attentes du personnel de l’ONU détaché auprès des équipes d’examen, privilégier la diversité dans la composition de ces équipes, et établir un flux de financement dédié. Les équipes d’examen indépendantes doivent mettre l’accent sur leur transparence et leur indépendance, et systématiser l’utilisation de méthodes et d’approches de recherche diverses.
Scenarios for the Future of Peace Operations
Scenarios for the Future of Peace Operations
- Jaïr van der Lijn, « Scenarios for the Future of Peace Operations», IPI Global Observatory, mai 2021. Jaïr van der Lijn développe quatre scénarios : multilatéral, multipolaire, fragmentation ou réseau. Le moment, la durée, le lieu, le but et la manière dont les OP sont déployées et par qui, dépendent de la manière dont la sécurité internationale est conçue dans chaque scénario. Elle déterminera le rôle que joueront les Nations unies, les normes qui dirigeront les OP et le caractère des missions déployées. Contrairement aux stratégies fondées sur des attentes ou aux prévisions extrapolant sur les expériences récentes, ces scénarios explorent des ruptures de tendance aidant ainsi à mieux se préparer à l’inattendu. En examinant ce qui est nécessaire pour chaque scénario, il est possible de réfléchir à diverses options stratégiques et d’élaborer un plan global qui augmentera la flexibilité organisationnelle de l’ONU et lui permettra de se préparer au futur.