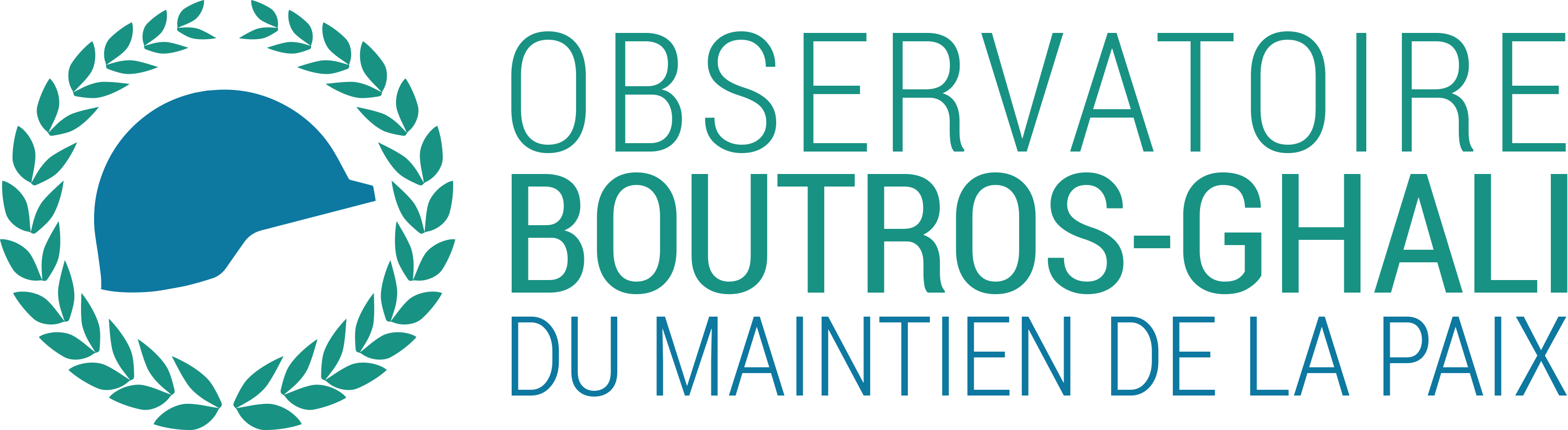Chiara Lanfranchi et al., « Tirer les enseignements des retraits des missions de paix de l’ONU au Mali et en RDC », The Conversation, décembre 2024
Chiara Ruffa, Sebastiaan Rietjens, « Mandate Interpretation and Multinational Collaboration in the UN mission in Mali », Folke Bernadotte Academy, avril 2024.
Les crises diverses et variées, les rebondissements géopolitiques et l’émergence d’acteurs non étatiques sont autant d’évènements qui bouleversent l’équilibre politique mondial aujourd’hui. Les Nations unies et les missions de maintien de la paix n’en sont pas moins impactées. Cet article explore les différentes causes remettant en question les missions onusiennes de maintien de la paix, essentiellement en Afrique, en prenant pour exemples la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) qui a pris fin en juin 2023, et la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) dont le retrait anticipé a été suspendu en raison de la situation sécuritaire instable.
L’article analyse les difficultés pour les mandats des missions de rester en phase avec les besoins concrets des pays hôtes. Alors que les missions durent souvent plusieurs années, la situation sécuritaire évolue plus rapidement que le mandat, écartant alors la mission de la réalité et laissant place au mécontentement de la population et des autorités. Ce scénario s’est produit avec la MINUSMA qui a rencontré de sérieuses difficultés à assurer la sécurité de la région. La situation est similaire pour la MONUSCO, même si les autorités n’ont pas réitéré leur demande de retrait anticipé de la mission en raison de l’escalade de la situation dans l’est du pays en 2024.Malgré ces critiques, l’article souligne pourtant que des études quantitatives démontrent que les pertes humaines baissent globalement à la suite de l’instauration d’une mission. « La présence des Casques bleus favorise la mise en œuvre d’accords de paix à l’issue des affrontements, d’autant plus lorsque des missions de paix politiques, missions politiques spéciales ou missions de bons offices sont mises en place conjointement. » De telles études permettent de limiter les effets de la crise de légitimité que vit l’ONU aujourd’hui.
L’article souligne également que plusieurs éléments et défis expliquent la situation dans laquelle se retrouvent les missions de paix aujourd’hui, notamment la présence accrue de groupes armés, mais aussi l’implication d’acteurs extérieurs avec leurs propres intérêts géopolitiques. L’article évoque également le sujet des sociétés militaires privées qui compliquent davantage la situation conflictuelle. L’article fait ensuite le point sur l’historique des missions de maintien de la paix depuis 1945. On remarque une baisse du nombre de missions de maintien de la paix durant ces deux dernières décennies, alors que le nombre de missions politiques reste stable. Un questionnement autour de l’avenir des missions de maintien de la paix clôt l’article. Le Pacte pour l’Avenir adopté par l’ONU en septembre 2024 est perçu comme un instrument à saisir afin de « repenser plus fondamentalement » les besoins des missions, en adaptant les mandats en fonction du contexte.Christopher Sims, « Information Sharing and the Effectiveness of Peacekeeping Operations in Mali », Military Review, septembre-octobre 2024.
Christopher Sims, « Information Sharing and the Effectiveness of Peacekeeping Operations in Mali », Military Review, septembre-octobre 2024.
Dans cet article publié dans Military Review, Christopher Sims, doctorant du King’s College de Londres, explore l’impact des pratiques de partage d’information au sein des organisations internationales. Il analyse la manière dont les informations sont collectées, traitées et diffusées et comment cela a un impact direct sur l’efficacité de ces organisations. Cet article se penche particulièrement sur le cas de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA, active entre 2013 et 2023).
L’argument clé de cet article est que le partage de l’information joue un rôle crucial dans l’amélioration du succès des opérations de maintien de la paix. Sims soutient qu’une information correctement traitée et partagée contribue fortement à la sécurité des troupes et à la réussite de la mission.
L’article commence par dresser un tableau factuel de la MINUSMA, qui repose sur un mandat peu clair, qui propose des recommandations plutôt que des directives fermes. Le langage utilisé dans le mandat est ambigu, et plusieurs équipes aux objectifs divergents participent à la mission. De plus, la diversité linguistique au sein des contingents complique encore la coordination. Il est donc difficile de partager des informations de manière uniforme et de maintenir un niveau de qualité cohérent, d’autant plus que l’environnement conflictuel du Mali rend la situation encore plus complexe.
Ensuite, l’article décrit la collecte d’information au sein d’une telle mission. L’information provient de sources diverses et variées : renseignements recueillis par des unités militaires, par des ONG, par la société civile. S’ajoutent à cela des directives venant de la hiérarchie et le mandat de la mission à honorer.
Dans le cadre de la MINUSMA, des centres d’opérations conjoints et des cellules de fusion pour regrouper des informations de diverses sources ont été mis en place. Ces structures facilitent la coordination entre les composantes militaires, policières et civiles de la mission et permettent d’améliorer la réactivité et l’efficacité de la mission.
Sims insiste également sur l’importance d’inclure les populations locales dans les processus d’échange d’informations. Cependant, il note une méfiance récurrente et réciproque entre les forces onusiennes et les populations locales.
La grande variété d’acteurs, de ressources, d’objectifs, d’ambitions, de stratégies, de sensibilités nationales et ethniques, dans un contexte souvent tendu, sont autant d’obstacles à une communication aisée – pourtant cruciale – pour la réussite de la mission.
L’article tire trois conclusions afin d’améliorer la transmission d’informations au sein de futures missions :
- La priorité devrait être donnée aux conversations civiles-militaires ;
- Une mémoire institutionnelle permettrait de conserver les acquis au sein des équipes de terrain, et pour les missions futures ;
- Des canaux de communication plus efficaces entre les acteurs locaux permettraient d’éviter que les sensibilités nationales ne compromettent la coopération et l’échange d’informations.
Stimson Center, « Nouveaux enseignements à tirer de l’expérience de la MINUSMA au Mali », International Peace Institute, Security Council Report, juillet 2024.
“Nouveaux enseignements à tirer de l’expérience de la MINUSMA au Mali”, International Peace Institute, Security Council Report, Stimson Center, 31 juillet 2024.
Cet article publié par le Stimson center est un résumé de discussions ayant eu lieu à Nairobi au Kenya en juin 2024 lors d’une série de dialogues organisé par le Stimson center afin de faire le point sur les différents modèles d’opérations de paix concernant la protection des civils. Ce dialogue intervient 25 ans après l’adoption par le Conseil de sécurité de la première résolution portant spécifiquement sur la protection des civils dans les conflits armés (S/RES/1265) et l’autorisation du déploiement d’une mission avec un mandat explicite de protection des civils, en Sierra Leone en 1999.
Les discussions rappellent que la protection des civils s’est imposée depuis deux décennies comme un enjeu central des opérations de paix de l’ONU mais des d’importants défis stratégiques et opérationnels restent à relever. Les participants sont revenus sur les différents outils de protection des civils mis en place par l’ONU mais aussi par les organisations régionales et sous régionales, particulièrement l’Union africaine. Cette dernière a une approche assez proche de l’ONU en termes de protection des civils mais se distingue par sa capacité à entreprendre des activités offensives ciblant directement les groupes armés et dépassant le cadre traditionnel de l’autodéfense ce qui peut s’apparenter à un avantage dans certains contextes mais comporte aussi d’importants risques pour les civils.
L’évolution des menaces à l’encontre des civils, a été également abordée, soulignant que cela oblige les opérations de paix à s’adapter continuellement et à développer d’autres outils de protection des civils. Les participants ont aussi souligné l’importance de développer les capacités nationales et locales de protection des civils, avec un accent sur le transfert des responsabilités de protection aux autorités hôtes et aux autres acteurs de la protection, particulièrement dans un contexte de transition de la mission déployée. L’engagement avec les communautés locales et la société civile a également été mentionné.
Une autre thématique abordée a été l’importance de mieux connaître et comprendre les avantages et les limites des missions dirigées au niveau régional en matière de protection des civils, et ce notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2719 (S/RES/2719) du Conseil de sécurité des Nations unies.
El-Ghassim Wane, « MINUSMA’s withdrawal from Mali: Brief overview of the mission’s performance and challenges, and lessons for peacekeeping in Africa », ACCORD, mai 2024.
El-Ghassim Wane, « MINUSMA’s withdrawal from Mali: Brief overview of the mission’s performance and challenges, and lessons for peacekeeping in Africa », ACCORD, 28 mai 2024.
Dans cet article d’ACCORD, El-Ghassim Wane, ancien Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et chef de la MINUSMA, fait l’état des leçons à tirer des défis rencontrés par la MINUSMA pour l’ensemble du maintien de la paix africain.
L’auteur commence par répondre aux discours qui qualifie selon lui à tort la MINUSMA d’échec, caractérisant un déclin à long terme des grandes opérations multidimensionnelles de maintien de la paix des Nations unies. Pour lui, ces observations sont problématiques à plusieurs niveaux. Premièrement, elles postulent implicitement qu’une opération de maintien de la paix peut pleinement remplir son mandat indépendamment de l’État hôte et des parties au processus de paix. Deuxièmement, ces discours ne reconnaissent pas suffisamment l’impact des facteurs extérieurs à la mission tels que les contextes régionaux et mondiaux changeants. Troisièmement, ils ne rendent pas justice au travail effectué sur le terrain dans des conditions souvent difficiles. En effet, malgré les défis rencontrés, la MINUSMA a toutefois facilité, en collaboration avec les structures étatiques concernées, la conclusion de plus de 30 accords de paix locaux. Aussi, l’ancien chef de la MINUSMA ajoute que les objectifs de la mission allaient au-delà d’assurer la sécurité physique des civils au Mali. Notamment, à la suite du coup d’État d’août 2020, le mandat de la MINUSMA a été élargi pour inclure l’appui à la transition vers un régime constitutionnel. L’auteur argumente qu’il est possible d’affirmer que la présence de la MINUSMA a permis aux structures étatiques de faire face aux défis auxquels la démocratie était confrontée. Également, l’expérience malienne a clairement montré que le partenariat politique entre les Nations unies et les acteurs africains est primordial. Selon l’auteur, les Nations unies et les acteurs africains devraient se consulter plus étroitement, pour aligner leurs stratégies et veiller à ce que leurs efforts se soutiennent mutuellement et ainsi maximiser leur capacité à influencer le cours des événements. L’auteur mentionne notamment le potentiel du cadre normatif élaboré par l’Union africaine en matière de gouvernance, de droits humains, de paix et de sécurité. L’auteur conclut en argumentant que l’expérience de la mission a également démontré l’importance de la cohérence stratégique entre l’État hôte et la mission de maintien de la paix, mais également celle du consensus international parmi les acteurs concernés.Chiara Ruffa, Sebastiaan Rietjens, « Mandate Interpretation and Multinational Collaboration in the UN mission in Mali », Folke Bernadotte Academy, avril 2024.
Chiara Ruffa, Sebastiaan Rietjens, « Mandate Interpretation and Multinational Collaboration in the UN mission in Mali », Folke Bernadotte Academy, avril 2024.
Dans cet article publié conjointement par le Challenges Foum, la Folke Bernadotte Academy, et l’Université de défense de la Suède, Chiara Ruffa et Sebastiaan Rietjens, respectivement professeure au centre d’études internationale de Sciences Po et directeur du Centre de recherche sur les études de guerre à l’académie de défense des Pays-Bas, explorent la manière dont les casques bleus venant du Nord global et du Sud global interagissent les uns avec les autres et interprètent le mandat de la mission dans laquelle ils sont déployés. Les auteurs s’appuient sur une étude de cas de la mission des Nations unies au Mali (MINUSMA) pour argumenter que la bonne gestion de la diversité est un facteur de réussite essentiel dans les opérations de maintien de la paix.
Les auteurs s’appuient sur 120 entretiens menés avec des soldats de la paix déployés dans plusieurs endroits du Mali entre 2014 et 2017. Ils argumentent que, lorsque les casques bleus sont déployés dans un contexte très ambigu, ils ne se contentent pas simplement d’obéir aux ordres mais interprètent leur mandat de manière à développer des stratégies de construction de sens. Les auteurs mettent en avant trois types de stratégie de construction de sens pour classifier les interactions des soldats du Nord avec ceux du Sud : le jardin de Voltaire, la construction de ponts et l’altérité. Le jardin de Voltaire repose le fait que les équipes se concentrent sur les objectifs de leur propre contingent sans réellement communiquer avec les autres unités. Cette stratégie entraîne des difficultés d’adaptation et parfois l’échec de la mise en œuvre de certains ordres. L’altérité, quant à elle, consiste à renforcer les différences et à reproduire les hiérarchies raciales et, dans certains cas, s’exprime sous la forme d’un racisme décomplexé. Cette stratégie est préjudiciable aux performances du maintien de la paix parce qu’il renforce les problèmes de coopération. La stratégie la plus bénéfique selon les auteurs, la construction de ponts, consiste à gérer la situation principalement par le biais d’interactions informelles avec d’autres contingents, parfois même en allant à l’encontre du mandat.
Les auteurs concluent avec trois recommandations. Premièrement, les Nations unies devraient promouvoir activement la construction de ponts entre les unités issues de contextes nationaux différents au sein des missions de maintien de la paix, afin de favoriser la cohésion et d’améliorer la compréhension des objectifs de la mission. Ensuite, des niveaux plus élevés de diversité culturelle devraient être mis en œuvre pour contrer les stéréotypes raciaux au sein des opérations. Enfin, une formation et une socialisation spécifiques avant le déploiement peuvent également être utilisées pour lutter contre ces stéréotypes.
Chloé Cosson, « What the Withdrawal of Minusma From Mali Says About Peacekeeping’s Future », Passblue, août 2023.
Chloé Cosson, « What the Withdrawal of Minusma From Mali Says About Peacekeeping’s Future », Passblue, 7 août 2023.
Zane Irwin et Baba Ahmed, « Malians who thrived with arrival of UN peacekeeping mission fear economic fallout from its departure », AP News, août 2023.
Zane Irwin et Baba Ahmed, « Malians who thrived with arrival of UN peacekeeping mission fear economic fallout from its departure », abc News, 2 août 2023.
Mady Ibrahim Kanté, « Mali crisis: UN peacekeepers are leaving after 10 years – what’s needed for a smooth transition », The Conversation, juillet 2023.
Mady Ibrahim Kanté, « Mali crisis: UN peacekeepers are leaving after 10 years – what’s needed for a smooth transition », The Conversation, 26 juillet 2023.
Eugene Chen, « The MINUSMA Liquidation Process Unpacked », International Peace Institute, juillet 2023.
Eugene Chen, « The MINUSMA Liquidation Process Unpacked », International Peace Institute, 24 juillet 2023.
Josh Jorgensen, « MINUSMA’s Termination and the Future of Protection in Mali », International Peace Institute, juillet 2023.
Josh Jorgensen, « MINUSMA’s Termination and the Future of Protection in Mali », International Peace Institute, 21 juillet 2023.
Jenny Lorentzen, « Exit UN, Enter the Wagner Group? The UN’s 10-year-old Mission in Mali is Ending », PRIO Blogs, juillet 2023.
Lisa Sharland, « MINUSMA and Protection of Civilians: Implications for Future Peacekeeping Missions », International Peace Institute, 14 juillet 2023.
Lisa Sharland, « MINUSMA and Protection of Civilians: Implications for Future Peacekeeping Missions », International Peace Institute, juillet 2023.
Lisa Sharland, « MINUSMA and Protection of Civilians: Implications for Future Peacekeeping Missions », International Peace Institute, 14 juillet 2023.
Víctor Casanova Abós, « The Primacy of Geopolitics: Five Lessons from the UN’s Involvement in Mali », International Peace Institute, juillet 2023.
Víctor Casanova Abós, « The Primacy of Geopolitics: Five Lessons from the UN’s Involvement in Mali », International Peace Institute, 12 juillet 2023.
Richard Gowan et Daniel Forti, « What Future for UN Peacekeeping in Africa after Mali Shutters Its Mission? », International Crisis Group, juillet 2023.
Richard Gowan et Daniel Forti, “What Future for UN Peacekeeping in Africa after Mali Shutters Its Mission?”, International Crisis Group, 10 juillet 2023.
Richard Gowan et Daniel Forti, “What Future for UN Peacekeeping in Africa after Mali Shutters Its Mission?”, International Crisis Group, 10 juillet 2023.
Djiby Sow, Hassane Koné et Fahiraman Rofrigue Koré, « MINUSMA leaves Mali: will regional leaders step up on security? », Institute for Security Studies, juillet 2023.
Djiby Sow, Hassane Koné et Fahiraman Rofrigue Koré, « MINUSMA leaves Mali: will regional leaders step up on security? », Institute for Security Studies, 6 juillet 2023.
Adam Day, « As Peacekeeping Exits Mali, the Transition Is a New Opportunity for the UN », International Peace Institute, juillet 2023.
Adam Day, « As Peacekeeping Exits Mali, the Transition Is a New Opportunity for the UN », International Peace Institute, 6 juillet 2023.
CIVIC, « MINUSMA’s Withdrawal Must Be Deliberate & Sequenced to Keep Protecting Civilians », Center for civilians in conflict (CIVIC), juillet 2023.
CIVIC, « MINUSMA’s Withdrawal Must Be Deliberate & Sequenced to Keep Protecting Civilians », Center for civilians in conflict (CIVIC), 4 juillet 2023.
Hamza Mohamed, « Analysis: What’s next for Mali after MINUSMA withdrawal? », Al Jazeera, juillet 2023.
Hamza Mohamed, « Analysis: What’s next for Mali after MINUSMA withdrawal? », Al Jazeera, 3 juillet 2023.
Aoife Croucher, « Au Mali, la Mission de maintien de la paix de l’ONU prend fin », Human Rights Watch, juin 2023.
Aoife Croucher, « Au Mali, la Mission de maintien de la paix de l’ONU prend fin », Human Rights Watch, 30 juin 2023.
« Départ de la Minusma du Mali: "L’enjeu, c’est un retrait négocié qui évitera un vide sécuritaire" », Entretien avec Arthur Boutellis, RFI, juin 2023.
RFI, Départ de la Minusma du Mali: « L’enjeu, c’est un retrait négocié qui évitera un vide sécuritaire », Entretien avec Arthur Boutellis, RFI, 27 juin 2023.
- RFI, Départ de la Minusma du Mali: « L’enjeu, c’est un retrait négocié qui évitera un vide sécuritaire », Entretien avec Arthur Boutellis, RFI, 27 juin 2023.
Jean-Hervé Jezequel et Ibrahim Maïga, « MINUSMA : Négocier un départ sans accroc », Crisis Group, juin 2023.
Jean-Hervé Jezequel et Ibrahim Maïga, « MINUSMA : Négocier un départ sans accroc », Crisis Group, 27 juin 2023.
- Jean-Hervé Jezequel et Ibrahim Maïga, « MINUSMA : Négocier un départ sans accroc », Crisis Group, 27 juin 2023. Disponible aussi en anglais.
Rémi Carayol, « Au Mali, "la Minusma pouvait gêner les Fama et Wagner" », Entretien avec Arthur Boutellis, Afrique XXI, juin 2023.
Rémi Carayol, Au Mali, « la Minusma pouvait gêner les Fama et Wagner », Entretien avec Arthur Boutellis, Afrique XXI, 26 juin 2023.
- Rémi Carayol, Au Mali, « la Minusma pouvait gêner les Fama et Wagner », Entretien avec Arthur Boutellis, Afrique XXI, 26 juin 2023.
Bakary Sambe, « Le départ "sans délai" de la MINUSMA constituerait une réelle menace pour le Mali et la région », Timbuktu Institute, juin 2023.
Bakary Sambe, « Le départ « sans délai » de la MINUSMA constituerait une réelle menace pour le Mali et la région », Timbuktu Institute, 20 juin 2023.
- Bakary Sambe, « Le départ « sans délai » de la MINUSMA constituerait une réelle menace pour le Mali et la région », Timbuktu Institute, 20 juin 2023.
Nina Wilén et Paul D. WIlliams, « The UN Security Council and the Future of MINUSMA », Institut Egmont, juin 2023.
Nina Wilén et Paul D. WIlliams, « The UN Security Council and the Future of MINUSMA », Institut Egmont, 19 juin 2023.
Rahmane Idrissa, « La mission de l’ONU au Mali était devenue impossible », Le Monde Afrique, juin 2023.
Rahmane Idrissa, « La mission de l’ONU au Mali était devenue impossible », Le Monde Afrique, 19 juin 2023
Bertrand Ollivier, « La MINUSMA : de puissance médiatrice à mission d’appui, itinéraire d’un mandat hasardeux», Le Rubicon, mai 2023.
Bertrand Ollivier, « La MINUSMA : de puissance médiatrice à mission d’appui, itinéraire d’un mandat hasardeux», Le Rubicon, 12 mai 2023.
- Dans cet article publié sur le site Le Rubicon, Bertrand Ollivier, chercheur associé à l’Observatoire Boutros-Ghali, fait le bilan de l’évolution du mandat de la MINUSMA à l’heure où celui-ci va être renégocié selon l’une des trois options présentées dans le rapport interne (S/2023/36) du Secrétaire Général du 16 janvier 2023. Afin d’éviter que la mission ne devienne un simple soutien logistique et matériel aux autorités maliennes, l’auteur réaffirme l’importance des quatre conditions à la perpétuation de la mission, présentées dans le dernier rapport (S/2023/236) du Secrétaire général. Ainsi selon lui il est nécessaire :
-
-
- Que la transition politique continue d’avancer,
- Que des progrès soient effectués dans l’accord de paix,
- Que la liberté de circulation de la mission soit garantie par les autorités maliennes, et ce même pour des opérations de surveillance ou de reconnaissance,
- Que la mission puisse s’occuper de l’intégralité de son mandat, et même des droits humains Selon l’auteur, depuis 2015, la mission ne fait que s’adapter aux évolutions sur le terrain. Dés l’institution du mandat de la MINUSMA en 2013 via la résolution 2100 (S/RES/2100) le terrain est déjà peu favorable au déploiement d’une mission puisqu’aucun cessez-le-feu n’est mis en place à l’époque. Toutefois, en 2013, la MINUSMA est encore bien perçue par l’État malien. Le chef de la mission, Bert Koenders prend une place centrale dans les négociations à Ouagadougou. Pourtant, en 2014, le contexte change et l’État malien commence à percevoir l’ONU comme partiale. Les négociations sont relocalisées à Alger, et la MINUSMA se retrouve avec un simple rôle d’appui technique. En 2016, la résolution 2295 (S/RES/2295) affirme que la mise en œuvre de l’Accord devient la priorité stratégique de la mission. Elle s’en chargera alors à travers deux pressions, l’une militaire en appui aux opérations du G5 Sahel, et l’autre politique en établissant des sanctions sur certains individus bloquant le processus de paix. En 2019, la résolution 2480 (S/RES/2480) instaure une seconde priorité stratégique pour la MINUSMA : la protection des civils, ce qui mène à un redéploiement ainsi qu’à la mise en place d’unités plus mobiles. Ainsi, l’appui à l’Accord de paix est maintenant secondaire par rapport à la protection des civils et au renforcement de l’autorité étatique. L’auteur critique le fait que la mission suit de plus en plus les priorités des autorités maliennes. À l’heure actuelle, nombreux sont ceux qui remettent en question la légitimité de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation. De plus, la MINUSMA a perdu la possibilité d’initiatives dans la mise en place de celui-ci. Néanmoins, l’auteur remarque que, malgré la lente perte d’influence de l’ONU au Mali, la mission a développé énormément de projets d’infrastructure et de développement.
-
Arthur Boutellis, « MINUSMA “à la carte’’ ou fin de partie géopolitique au Mali », Le Rubicon, mars 2023.
Arthur Boutellis, « MINUSMA “à la carte’’ ou fin de partie géopolitique au Mali», Le Rubicon, 10 mars 2023.
Arthur Boutellis, conseiller senior à l’International Peace Institute (IPI), revient dans cet article sur l’avenir de la MINUSMA. Il commence par rappeler les trois solutions pour l’avenir de la mission présentées en janvier : une augmentation des effectifs de la mission, un nombre similaire de personnel mais réparti différemment et pour finir, le retrait militaire pour laisser place à une mission exclusivement politique. Depuis le coup d’Etat de 2021, les relations entre la MINUSMA et les autorités maliennes sont devenues relativement tendues. Bamako ne désire pourtant pas le retrait total de la MINUSMA, car l’État se sert des transports de la mission pour faire voyager ses autorités et ses forces armées. De plus, il veut conserver le soutien logistique, alimentaires et les renseignements que la mission lui fournit. Cependant, les autorités maliennes refusent toute intervention sur les questions des droits humains et empêchent fréquemment les vols de la MINUSMA. Bamako désire en fait une mission « à la carte », qui appuierait les aspects dont les autorités ont besoin comme les réhabilitations d’infrastructures, notamment militaires, ou encore la sécurisation de certaines villes et axes importants. Une mission politique laisserait retomber le nord malien entre les mains terroristes. L’option d’une MINUSMA reconfigurée mais qui conserverait le même personnel pourrait potentiellement être une solution privilégiée. Face à la situation, de nombreux pays contributeurs ont décidé de retirer leurs troupes. De plus, le processus de paix n’avance pas. Les autorités de transition seraient occupées à asseoir leur légitimité et ne mettent pas assez de choses en place pour arriver à un accord de paix effectif. Les autorités maliennes sont d’ailleurs sorties du G5 Sahel et ont demandé le retrait des troupes françaises. En parallèle à la fin de Barkhane, la société russe Wagner est arrivée au Mali. Le pays semble être un nouveau terrain d’affrontement pour les velléités occidentales et russes. Les Occidentaux accusent Wagner et les forces maliennes de violations contre les civils. Au contraire, les Russes affirment que la désinformation occidentale sert à décrédibiliser le régime malien. L’auteur conclut par un bilan de la situation. Les menaces terroristes ont forcé la mission à s’adapter, même si ça a été parfois au dépend de la protection des populations civiles. Les forces occidentales ont aidé à la modernisation du maintien de la paix, notamment dans l’importance marquée pour certains sujets comme l’utilisation du renseignement par les missions. L’impartialité de l’ONU a été remise en question face à sa coopération avec les missions militaires de contre-terrorisme comme Barkhane ou le G5 Sahel. Face à ces recompositions, l’auteur conseille à l’ONU de conclure cette mission et d’impliquer plutôt une force africaine sur place. Pour lui, le retrait de la MINUSMA signera sans conteste la fin des opérations multidimensionnelles de stabilisation.
Mélanie Sauter, « A Shrinking Humanitarian Space: Peacekeeping Stabilization Projects and Violence in Mali », International Peacekeeping, janvier 2023.
Mélanie Sauter, “A Shrinking Humanitarian Space: Peacekeeping Stabilization Projects and Violence in Mali”, International Peacekeeping, janvier 2023.
À travers l’exemple de la MINUSMA, Melanie Sauter, chercheuse à l’Université d’Oslo, se penche sur l’influence des missions intégrées de stabilisation de l’ONU sur l’espace et l’aide humanitaires mais aussi plus largement sur la violence à l’encontre des populations civiles. L’auteure commence par aller à l’encontre d’une théorie soutenue par les humanitaires qui affirme que les missions de l’ONU les placent dans des situations d’insécurité où ils sont beaucoup plus à risque d’être pris pour cible. Elle reprend ainsi des données témoignant du fait que les pays qui accueillent une mission n’ont pas nécessairement plus de morts travaillant dans l’humanitaire, au contraire les pays avec le plus d’humanitaires tués n’ont pas de mission onusienne sur leur sol. L’auteure estime que les missions réduisent l’espace humanitaire et limite l’accès au terrain et identifie deux facteurs majeurs de ce phénomène. Le premier est la politisation des mandats d’aide. Dans ce cadre, les objectifs politiques et militaires sont mis en avant par rapport aux objectifs humanitaires. Le second est le fait qu’il y a une forme de confusion entre la délimitation des actions humanitaires d’un côté et des actions militaires de l’autre côté. Cet élément est notamment présent dans les projets de stabilisation du maintien de la paix : les populations bénéficiant de ces missions sont souvent plus touchées par la violence. Du point de vue la sécurité des humanitaires, c’est bien la réduction de l’espace dédié aux ces derniers qui permet d’expliquer les chiffres peu élevés des morts chez eux : ils ont moins d’accès aux populations touchées et donc se rendent moins sur le terrain. L’article soulève un paradoxe : l’ONU a noté les limitations de l’accès humanitaire comme étant un des défis majeurs à une protection efficace des civils. Pourtant, ce sont leurs missions de stabilisation au mandat intégré qui rendent l’accès compliqué aux humanitaires, selon Mélanie Sauter. Les implications sur le terrain sont doubles. Premièrement, l’ONU doit être consciente que les activités de stabilisation sont dangereuses pour les civils et les humanitaires et qu’elles diminuent l’accès des humanitaires aux populations locales. Dans un second temps, les humanitaires eux-mêmes doivent prendre en compte dans leur prévision les activités de stabilisation des missions car leur accès aux civils sera réduit.
Clair MacDougall, Maggie Dwyer, « Serious Troop Rotation Blockages Could Ease Soon for the UN Mission in Mali », PassBlue, juillet 2022.
Clair MacDougall, Maggie Dwyer, « Serious Troop Rotation Blockages Could Ease Soon for the UN Mission in Mali », PassBlue, 4 juillet 2022.
Dans cet article publié par PassBlue, Clair MacDougall et Maggie Dwyer reviennent sur les retards des rotations des troupes de casques bleus au Mali. Ces derniers sont le fruit d’une décision des autorités maliennes de refuser les autorisations de vols aux pays de la CEDEAO, en représailles des sanctions imposées par celle-ci à Bamako. En conséquence, le Sénégal, le Liberia, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana n’ont pas pu assurer la rotation de leurs troupes déployées à la MINUSMA depuis février 2022. L’article souligne tout d’abord la récente levée des sanctions imposées au Mali par la CEDEAO dans un geste de conciliation, les pays membres espérant ainsi une reprise des rotations. L’article rappelle le rapport du Secrétaire Général des Nations unies, António Guterres, paru en juin 2022, où l’ONU s’inquiète pour la sécurité de son personnel ainsi que celle des travailleurs humanitaires au Mali. Le rapport appelle aussi le pays à autoriser les vols nécessaires pour les rotations de troupes. L’ONU dénonce également l’augmentation des restrictions des déplacements de la MINUSMA sur le territoire malien ainsi que celles concernant les vols d’évacuations médicales. MacDougall et Dwyer concluent en évoquant les conséquences que les retards de rotation des troupes ont sur les soldats. Selon les interviews menées auprès des soldat.e.s déployé.e.s dans le cadre de la MINUSMA, Ces retards sont le premier facteur de stress pour eux. Cela concorde avec les déclarations des pays d’Afrique de l’Ouest concernant la baisse de moral des troupes bloquées au Mali qui ont pour conséquence des problèmes disciplinaires. Le deuxième enjeu soulevé par les soldats est l’impact que le retard des rotations a sur leurs familles. Même si les salaires pendant les missions de paix sont significativement plus élevés, les casques bleus soutiennent que le stress imposé à leurs familles n’en vaut pas la peine.
Seán Smith, « Preventing the UN Peacekeeping Mission in Mali from Falling into Irrelevance », Just security, juin 2022.
Seán Smith, « Preventing the UN Peacekeeping Mission in Mali from Falling into Irrelevance », Just security, juin 2022.
Seán Smith propose une analyse sur l’avenir incertain de la MINUSMA à quelques jours du renouvellement de son mandat. Les négociations de ce nouveau mandat de la Mission par le Conseil de sécurité apparaissent dans un contexte tumultueux, marqué par le départ des troupes françaises et européennes du Mali. Selon l’auteur, les discussions au sein du Conseil de sécurité devraient traduire une séparation entre les États membres qui encourageront la mise en place d’un mandat soucieux de la protection des civils et d’autres États qui mettront l’accent sur le respect de la souveraineté des pays. Cette séparation est accentuée par la guerre en Ukraine qui divise les pays occidentaux et la Russie. Pendant ce temps, le nombre d’attaques meurtrières contre les civils ne cesse d’augmenter, entrainant le déplacement d’au moins 350 000 personnes, en décembre 2021. Pour l’auteur, la situation doit pousser à maintenir la présence de la MINUSMA au centre du Mali pour renforcer la sécurité des civils particulièrement touchés dans cette zone. De plus, Seán Smith affirme que le nouveau mandat doit conserver une composante militaire, car la réponse armée est actuellement le seul moyen pour la Mission de protéger les civils des activités des groupes extrémistes. En outre, l’auteur propose également plusieurs modifications qui devraient permettre le renforcement du mandat de la MINUSMA : 1) réaffirmer l’importance de la capacité de la MINUSMA à enquêter sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme 2) éviter de soutenir les unités maliennes qui seraient impliquées dans des exécutions sommaires, la torture de suspects et les atteintes aux civils. 3) Renforcer le poids de la MINUSMA auprès des autorités maliennes afin qu’elle ne soit pas marginalisée 4) fournir un soutien logistique et financier dans l’organisation des réformes électorales pour soutenir le processus de transition.
Naureen Chowdhury Fink and Arthur Boutellis, « Between a Rock and a Hard Place: Counterterrorism and Peacekeeping in the Sahel », IPI Global Observatory, juillet 2021.
Naureen Chowdhury Fink and Arthur Boutellis, « Between a Rock and a Hard Place: Counterterrorism and Peacekeeping in the Sahel », IPI Global Observatory, juillet 2021.
Naureen Chowdhury Fink et Arthur Boutellis évoquent le rôle des opérations de paix de l’ONU dans la lutte contre la violence terroriste au Mali suite à l’annonce récente du président français sur la fin de l’opération Barkhane. Les débats concernant l’inclusion ou non d’actions contre le terrorisme au sein des OP mettent en exergue l’absence de doctrine ou d’orientation cohérente sur la façon d’agir face à ces menaces. L’introduction formelle d’un mandat antiterroriste dans les OP demeure une crainte. Les auteurs justifient cette réticence en évoquant plusieurs lacunes. Premièrement, le bilan des risques posés par les groupes terroristes est lourd. La MINUSMA est la mission de l’ONU qui a enregistré le plus grand nombre de décès au cours des huit dernières années. Représentant déjà une cible, l’ajout explicite d’un mandat contre le terrorisme ‘politiserait’ et exposerait encore plus la mission. Deuxièmement, les auteurs soulèvent le problème de cloisonnements bureaucratiques au sein de l’ONU, limitant la coordination entre les OP, les agences et les autres organes qui peuvent être actifs dans le domaine de la lutte contre le terrorisme : plus de quarante entités différentes au sein de l’ONU sont dédiées à ces sujets. Ce constat met aussi en exergue la nécessité de la part des entités de l’ONU de continuer à affiner leur compréhension des risques politiques et sécuritaires : au regard des mandats de la MINUSMA pour la protection des civils et pour une meilleure gouvernance, celle-ci ne doit plus ignorer les exactions vécues par la population aux mains d’acteurs étatiques, par ailleurs un des facteurs les plus constants de la radicalisation des individus. Une interrogation majeure demeure : quel est le type de coopération en matière de contre-terrorisme possible entre la MINUSMA, les forces restantes de Barkhane, la force conjointe du G5 Sahel, l’armée malienne et les acteurs de l’ONU ? Selon les auteurs, ce moment constitue une occasion importante pour travailler collectivement à établir des approches plus intégrées de la prévention et de la lutte contre le terrorisme.
Judd Devermont et Marielle Harris, « Why Mali needs a new peace deal », Center for Strategic and International Studies, avril 2021.
Judd Devermont et Marielle Harris, « Why Mali needs a new peace deal », Center for Strategic and International Studies, avril 2021.
Judd Devermont et Marielle Harris affirment que l’Accord d’Alger de 2015 pour la paix et la réconciliation au Mali est en train d’échouer, alors que sa mise en œuvre figure parmi les priorités stratégiques du mandat de la MINUSMA. Selon l’article, l’Accord souffre de plusieurs manques, notamment celui d’inclure des parties prenantes. Il cite notamment le cas des islamistes, de la société civile, des femmes et des jeunes. L’accord souffrirait également d’une portée géographique limitée. À l’époque de sa rédaction, la question séparatiste au nord du pays était la priorité en matière de sécurité. Aujourd’hui, le centre du pays est touché de plein fouet par les attaques commises par les groupes armés. Troisièmement, l’article affirme que l’Accord souffre d’un déficit d’adhésion politique. Le manque d’engagement aussi bien de la part du gouvernement, qui n’a pas su mettre en place un mécanisme de suivi de l’accord efficace, et de la part des anciens groupes rebelles – l’on rappelle que la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), partie signataire à l’accord a suspendu sa participation aux réunions de suivi durant plusieurs mois – a particulièrement fragilisé sa mise en œuvre. Les auteurs fournissent également des recommandations, notamment une concernant le rôle de la MINUSMA. Selon eux, l’ONU devrait revoir le mandat de la Mission pour incorporer le cadre remanié résultant de négociations élargies. En 2019, le CSNU a chargé la MINUSMA de soutenir le rétablissement de l’autorité de l’État dans le centre du Mali. « Il s’agirait là d’un bon premier pas, mais il faudrait faire davantage pour coordonner et protéger les efforts de paix entre les communautés et pour superviser la sécurité associée aux stratégies politiques et militaires contre les groupes djihadistes ».
Center for Civilians in Conflict, « What Does MINUSMA’s Revised Mandate Mean for the Protection of Civilians in Mali? Part 2: A More Detailed Approach to Mitigating Civilian Harm », août 2019.
Center for Civilians in Conflict, What Does MINUSMA’s Revised Mandate Mean for the Protection of Civilians in Mali? Part 2: A More Detailed Approach to Mitigating Civilian Harm, août 2019.
Dans la continuité de la Partie 1 de son étude parue en juillet dernier, le Center for Civilians in Conflict a publié une seconde partie au mois d’août 2019. Si la première partie décrivait le nouveau mandat de la MINUSMA, davantage centré sur la protection des civils (POC), la seconde partie affirme que la Mission onusienne détient le mandat le plus avancé en la matière. Ainsi, en plus d’ajouter une distinction entre les missions de stabilisation et les missions de POC, le Conseil de sécurité précise que la POC s’atteint en « suivant, en prévenant, en minimisant et en réparant les dommages causés aux civils par les opérations de la mission ». L’auteur voit dans cette importante précision une opportunité pour la MINUSMA de rendre son mandat plus efficace, d’autant qu’il est important de rappeler que la Mission malienne représente aujourd’hui l’OMP la plus meurtrière pour les Casques bleus.
Jaïr van der Lijn et al., « Assessing the Effectiveness of the United Nations Mission in Mali (MINUSMA) », Norwegian Institute of International Affairs, avril 2019.
EPON, Assessing the « Effectiveness of the United Nations Mission in Mali / MINUSMA », avril 2019.
Dans cette quatrième édition, le rapport sur l’efficacité de la MINUSMA évalue dans quelle mesure la mission réalise ses objectifs stratégiques et quel est son impact sur la situation politique et sécuritaire au Mali. À l’aune du renouvellement du mandat de la MINUSMA, prévu pour le 30 juin 2019, ce rapport revient sur les options qui permettraient à la mission d’accroitre son efficacité. Le recentrage stratégique de la MINUSMA afin de protéger les civils dans la région du centre, le déploiement d’un contingent au centre-Mali avec la possibilité de fonctionner en tant que force d’interposition dans les conflits communautaires y sont notamment abordés. Résumé disponible en français
Arthur Boutellis, Marie-Joëlle Zahar, « A Process in Search of Peace: Lessons from the Inter-Malian Agreement », IPI, juin 2017.
Arthur Boutellis, Marie-Joëlle Zahar, « A Process in Search of Peace: Lessons from the Inter-Malian Agreement », IPI, juin 2017.
Arthur Boutellis et Marie-Joëlle Zahar, ont dressé un bilan des accords de paix d’Alger, deux ans après sa mise en œuvre définitive le 20 juin 2015. L’article montre que malgré un solide soutien de la communauté internationale envers l’État malien, les limites des accords restent flagrantes et les objectifs fixés, rien qu’au niveau sécuritaire, sont loin d’être atteints. Selon les chercheurs, la dégradation de la situation s’explique par plusieurs problèmes persistants. Tout d’abord, le gouvernement malien ne s’investit pas suffisamment dans la mise en œuvre des accords, et lorsqu’il le fait, il a tendance à « imposer » l’accord provoquant des tensions avec les groupes armés rebelles. En outre, la difficile délimitation des groupuscules et leurs transformations continues (fragmentation/recomposition) a compliqué la tâche des équipes de médiation. En effet, très vite, les factions armées auraient fait primer leurs intérêts individuels ou communautaires par rapport au respect du processus de paix, ce qui par ricochet, a alimenté l’insécurité.De surcroit, l’apparition de nouvelles menaces mal identifiées dans les accords d’Alger, comme le terrorisme et les commerces illicites, ont bloqué le processus de sortie de crise. Les fractures entre le nord et le sud du pays restent très marquées car le gouvernement malien n’a pas suffisamment informé l’ensemble de la société malienne sur ce que pourrait lui apporter directement une réconciliation et les dividendes de la paix. Enfin, pour les deux chercheurs, il est plus que nécessaire que la communauté internationale possède une vision stratégique unique et continue de s’engager de manière constante sur le dossier malien.
Signe Marie Cold-Ravnkilde, Peter Albrecht, Rikke Haugegaard, « Friction and Inequality among Peacekeepers in Mali », The RUSI Journal Online, juin 2017.
Document PDF à télécharger
Signe Marie Cold-Ravnkilde, Peter Albrecht, Rikke Haugegaard, « Friction and Inequality among Peacekeepers in Mali », The RUSI Journal Online, juin 2017.
Signe Marie Cold-Ravnkilde, Peter Albrecht et Rikke Haugegaard avancent qu’il existe des inégalités et des frictions entre les forces des différents pays contributeurs de troupes engagés dans la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) qui affectent l’efficacité de la mission. Les soldats africains seraient davantage exposés au danger et plus fréquemment tués que leurs homologues européens. Ceci s’explique pour plusieurs raisons. Premièrement, culturellement parlant, les États européens restent plus réticents à envoyer des troupes au sol, et plus particulièrement dans un contexte aussi hostile que celui du Mali. En résulte un nombre de soldats africains dix fois supérieur à celui d’Européens dans la mission. Ensuite, les soldats européens sont généralement déployés dans des zones moins dangereuses que les Africains, avec des rôles stratégiques ou de coordination. Ceci s’explique par une doctrine militaire différente, et par le fonctionnement des mécanismes de génération de force de l’Organisation des Nations unies, couplé à l’intérêt de certains pays africains à envoyer des troupes dans le pays en général (par exemple, le Tchad qui souhaite s’affirmer comme puissance régionale) ou dans certaines zones particulières (par exemple, le Niger qui souhaite contrôler sa frontière). De plus, les soldats européens sont généralement mieux équipés et soutenus par leurs gouvernements que leurs homologues africains. Selon les auteurs, les différences de traitement et les priorités différentes des pays contributeurs de troupes entre eux et avec la MINUSMA, provoquent des frictions qui mettent à mal la coordination et, in fine, l’efficacité des missions. Afin de contrer ce phénomène, et en l’absence de lignes directrices plus claires du Conseil de sécurité de l’ONU quant aux implications pratiques de la mise en œuvre du mandat de stabilisation de la MINUSMA, S. M. Cold-Ravnkilde, P. Albrecht et R. Haugegaard préconisent un renforcement des interactions inter-pays contributeurs dans les tâches quotidiennes des soldats de la MINUSMA.
Annelies Hickendorff, Jaïr van der Lijn, « Renewal of MINUSMA: a missed opportunity for new generation of DDR », SIPRI, juin 2017.
Annelies Hickendorff, Jaïr van der Lijn, “Renewal of MINUSMA: a missed opportunity for new generation of DDR”, SIPRI, juin 2017.
Annelies Hickendorff et Jaïr van der Lijn ont déclaré que le Conseil de sécurité des Nations unies avait manqué une opportunité de relancer le processus de DDR (Désarmement, Démobilisation et Réintégration) au Mali en ne mettant pas assez l’accent sur ce point particulier lors du renouvellement du mandat de la MINUSMA en juin 2017. En effet, malgré le déploiement de plusieurs forces antiterroristes au Mali, le processus de DDR a pris un certain retard et l’insécurité continue à s’étendre dans le pays chaque année. Tout d’abord, le processus de DDR actuel est seulement destiné aux membres signataires des accords de paix d’Alger (2015) alors qu’il ne prend aucunement en compte la réintégration sociale ou militaire des groupes non signataires, considérés comme « extrémistes ». Or, cette vision simpliste et binaire des forces, visant à opposer les groupes signataires du traité (considérés comme « groupes rebelles ») aux groupes composés de « terroristes islamistes », n’est pas adaptée au paysage politique malien puisque la motivation première des « groupes extrémistes » n’est pas seulement la religion. En effet, la MINUSMA ne prendrait pas assez en compte les causes profondes de la violence en refusant d’étudier en profondeur les racines des conflits locaux, c’est-à-dire le ressentiment d’exclusion politico-économique par le gouvernement ou la compétition régionale entre les groupes pour contrôler les routes de la drogue. En outre, selon les deux chercheurs, le DDR ne répond pas aux besoins et aux motivations individuelles des combattants. Les groupes restent profondément fragmentés et les affiliations des soldats pourraient être facilement remises en question si on leur offre une protection et un solide emploi. En somme, selon Annelies Hickendorff et Jaïr van der Lijn, le processus de DDR doit être pleinement intégré aux opérations de contreterrorisme et il doit viser l’ensemble des combattants au Mali. Il est indispensable que le programme de DDR de la MINUSMA mette un terme à cette dichotomie opposant les groupes « rebelles » aux groupes « extrémistes ». L’approche de ce processus doit être plus compréhensive et se pencher sur les réelles causes de la violence et les motivations personnelles des combattants. Ainsi, la prochaine génération malienne sera capable de jouer un rôle dans la prévention et le rejet de l’extrémisme violent.
Peter Albrecht et al., « Inequality in MINUSMA: African Soldiers are in the Firing Line in Mali », Danish Institute for International Studies, décembre 2016.
Peter Albrecht et al., « Inequality in MINUSMA: African Soldiers are in the Firing Line in Mali », Policy Brief Dansk Institut for Internationale Studier, décembre 2016.
Peter Albrecht et al. ont publié un rapport sur les conditions de déploiement de la MINUSMA. Leur recherche souligne que les soldats européens et africains déployés au Mali dans le cadre de la MINUSMA, bénéficient de conditions de travail très différentes – notamment au regard de leur entrainement, de leur équipement, et du soutien général qu’ils sont en mesure d’attendre de la part de leurs gouvernement respectifs. Ces différences se superposent avec des disparités en termes de déploiements. Alors que les forces européennes sont concentrées dans les centres opérationnels de la mission, les forces africaines prennent en charge la majorité des opérations dans les territoires dangereux, aux frontières de l’opération de paix – disparités qui se retrouvent dans la composition des pertes humaines au sein de la MINUSMA. Ces différences en termes de conditions de travail soulèvent un ensemble de problèmes techniques et politiques, et diminuent la capacité de la MINUSMA à mettre en œuvre son mandat.