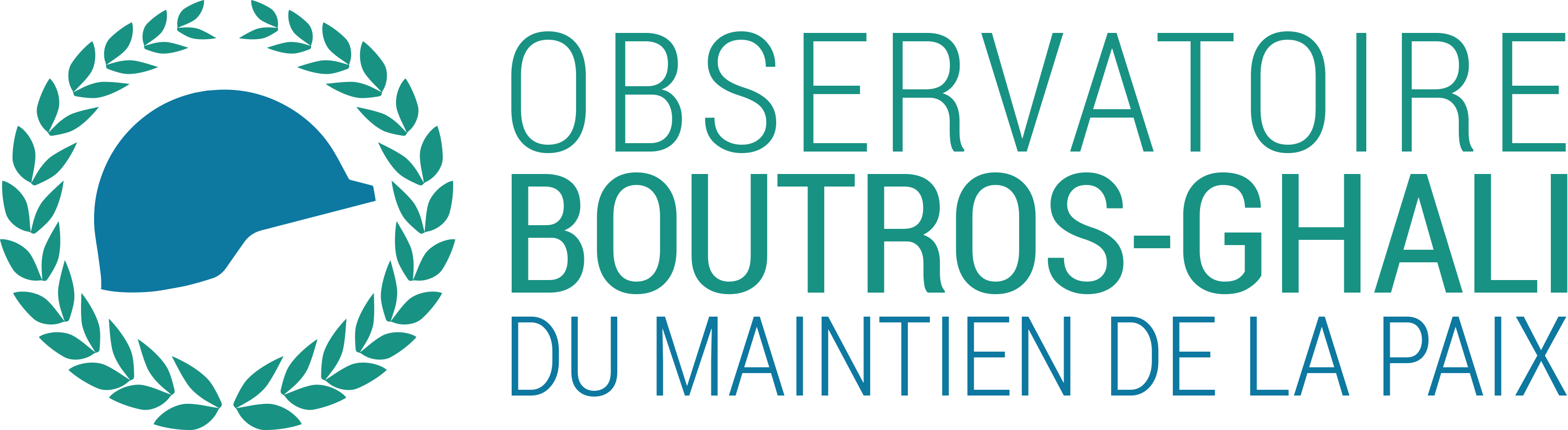Charles T. Hunt, « Specialized Police Teams in UN Peace Operations: A Survey of Progress and Challenges », IPI, mars 2024.
Charles T. Hunt, « Specialized Police Teams in UN Peace Operations: A Survey of Progress and Challenges », IPI, mars 2024.
Dans ce rapport publié sur le site de l’International Peace Institute (IPI), Charles T. Hunt, professeur à l’Institut royal de technologie de Melbourne, s’intéresse aux Équipes de police spécialisées (EPS) des opérations de paix (OP) des Nations unies. Ces dernières sont déployées depuis environ quinze ans au sein des OP, afin de renforcer les unités de polices constituées (UPC) ainsi que les officiers de police individuelles (OPI). Ces EPS sont constituées d’experts de la police qui ont des objectifs spécifiques, souvent en termes de transfert de compétences et de renforcement des capacités de la police locale.
L’auteur commence par revenir sur la genèse de ces EPS, les conditions de leur déploiement ainsi que leur consolidation et codification progressive, qui leur a permis de devenir aujourd’hui des éléments indispensables de l’architecture onusienne du maintien de la paix.Il s’intéresse ensuite aux avantages offerts par ces EPS. Charles T. Hunt précise que les EPS sont des équipes très compétentes qui permettent de se concentrer sur des objectifs précis et qui peuvent être déployées très rapidement. Un des autres avantages soulignés est le fait que ces EPS utilisent des approches durables et innovantes de renforcement des capacités, notamment la formation des formateurs. L’auteur explique aussi que ces équipes sont parfois plus avantageuses pour les pays contributeurs ainsi que pour le personnel déployé, notamment en termes d’expérience.
Hunt souligne également les inconvénients et défis inhérents à l’utilisation des EPS dans les OP onusiennes. Il évoque ainsi les possibles tensions et le manque de coordination qui peuvent survenir à différents niveaux décisionnels. Les problèmes de financement et d’approvisionnement sont également cités. De plus, il existe un risque de déconnexion des EPS avec les objectifs plus larges de la mission de l’ONU, en raison de la spécificité de leurs objectifs et de leur concentration sur le court terme. Le manque d’un cadre formel de suivi et d’évaluation est également évoqué.
L’auteur termine ce rapport par une série de recommandations destinées au Secrétariat de l’ONU, aux missions elles-mêmes ainsi qu’aux États membres. Il appelle à plus d’innovation et d’harmonisation pour le déploiement et la mise en œuvre des EPS, tout en soulignant l’importance de la flexibilité et de l’adaptabilité afin de réellement optimiser le potentiel des EPS.
Abdul Wasay Mandokhail, « The Transformative Role of Artificial Intelligence in Conflict Resolution and Peacekeeping », NUST Journal of International Peace and Stability, Janvier 2024.
Abdul Wasay Mandokhail, « The Transformative Role of Artificial Intelligence in Conflict Resolution and Peacekeeping », NUST Journal of International Peace and Stability, 31 Janvier 2024.
Dans cet article du Journal of International Peace and Stability de l’Université des sciences et technologie du Pakistan, Abdul Wasay Mandokhail, diplômé de la National Defense University d’Islamabad, souligne l’impact de l’évolution de l’intelligence artificielle sur souligne l’impact de l’intelligence artificielle sur les conflits, la sécurité, l’éthique et la surveillance, mettant en lumière à la fois les opportunités et les défis associés à son utilisation dans ces domaines. Il s’appuie majoritairement sur l’article d’Omar M intitulé « The Application of Artificial Intelligence (AI) in Peacekeeping Operation ». L’intelligence artificielle est devenue essentielle dans plusieurs domaines, mais le débat est souvent mené par des entreprises technologiques et des ingénieurs, négligeant les apports des sciences sociales. Abdul Wasay Mandokhail préconise une approche plus équilibrée et inclusive pour s’adapter au paysage en constante évolution de l’intelligence artificielle.
Dans un premier temps, il met en avant le potentiel de l’intelligence artificielle à révolutionner les stratégies militaires et à renforcer les processus de paix nationaux et internationaux. Toutefois, malgré les investissements massifs dans l’IA pour la défense, des préoccupations émergent quant à son utilisation possible dans des scénarios de guerre, soulignant ainsi la nécessité urgente de développer des stratégies pour la gestion des conflits.
Abdul Wasay Mandokhail souligne également l’importance de reconnaître les avantages et les préoccupations associés à l’intégration de l’IA dans les opérations militaires, citant la « Recommandation sur l’éthique de l’Intelligence Artificielle » de l’UNESCO, qui aborde les droits humains et les problèmes de biais dans les applications de l’IA.
En ce qui concerne le rôle de l’IA dans le maintien de la paix et la résolution des conflits, l’auteur précise qu’il est impératif de souligner les avantages potentiels de cette technologie pour la prévention des conflits et de la sécurisation des missions de maintien de la paix. Il cite par exemple, des technologies comme CogSolv peuvent améliorer la compréhension entre les parties en conflit, ouvrant ainsi la voie à des solutions mutuellement bénéfiques. De plus, l’IA renforce la sécurité des missions de maintien de la paix en réduisant les risques humains et en améliorant les capacités de détection des menaces.
Ainsi, en guise de conclusion Abdul Wasay Mandokhail nous rappelle que l’intégration croissante de l’intelligence artificielle dans la résolution de conflits, exige des mesures proactives pour atténuer les préjudices. Des cadres politiques solides et des considérations éthiques sont essentiels pour exploiter son potentiel tout en favorisant la paix dans le monde.
Gabriel Delsol et Albert Trithart, « Sustaining the UN Response to Infodemics », International Peace Institute Global Observatory, juillet 2023.
Gabriel Delsol et Albert Trithart, “Sustaining the UN Response to Infodemics”, International Peace Institute Global Observatory, 21 juillet 2023.
« Dans ce court article de l’International Peace Institute Global Observatory, les chercheurs Gabriel Delso et Albert Trithart s’intéressent à la façon dont l’ONU fait face aux infodémies. Ce concept d’infodémie est défini par l’Organisation mondiale de la santé en un surplus d’informations – parmi lesquelles des énoncés fallacieux ou trompeurs, en temps de pandémie. Ce phénomène, particulièrement prégnant pendant l’épidémie de COVID-19, a des conséquences directes sur les politiques de santé publique. Alors que la pandémie a été déclarée officiellement terminée au mois de mai dernier par l’OMS, les problèmes liés à l’infodémie persistent car les causes profondes de ce trouble de l’information ne sont pas résolues.
Une de ces raisons principales est la vulnérabilité de l’environnement informationnel et médiatique. Ceci implique un bas niveau d’éducation aux médias digitaux, un manque d’accès à du journalisme de qualité ou encore l’incapacité des plateformes de communications et de réseaux sociaux à prévenir et répondre à la désinformation. Dans ce contexte, l’ONU a joué un rôle crucial dans la réponse à la désinformation sur le COVID. Soutenant des initiatives telles que la campagne de factchecking Verified sur les réseaux sociaux, elle a aussi permis l’acquisition de compétences au niveau national pour surveiller et répondre à la désinformation plus générale.
Restent cependant de nombreux défis. En premier lieu, les auteurs soulignent l’absence de définition consensuelle de l’infodémie et des troubles de l’information au sein de l’ONU. Une compréhension commune pourrait clarifier les différentes mesures à prendre au sein des différents organes face à ce problème. Dans un second temps, il faudra maintenir et développer les compétences du personnel de l’ONU. En effet, le personnel engagé sur le temps court dans la gestion de la communication pendant le COVID a développé une bonne expertise des environnements informationnels actuels. Nombre de ces personnes sont à présent à la fin de leur contrat, et le savoir qu’elles ont construit sur les troubles de l’information pourrait être perdu. Dans un troisième temps, les auteurs soulignent l’importance d’harmoniser l’approche onusienne des nouvelles technologies d’information, et de travailler avec les plateformes de réseaux sociaux pour traiter le problème de la désinformation. Enfin, le développement de compétences nationales en matière de communication durant les crises de santé publique permettra de répondre aux infodémies de manière efficace. Dans ce cas, l’ONU devra s’assurer que ces capacités nouvelles ne portent pas atteinte à la liberté d’expression. »
Ingrid Munch et Aiko Holvikivi, « Measuring and documenting the contribution of gender training to transforming peacekeepers’ mindsets and behaviours », DCAF, février 2022
Ingrid Munch et Aiko Holvikivi, Measuring and documenting the contribution of gender training to transforming peacekeepers’ mindsets and behaviours, DCAF, février 2022
Cette annexe complète le document ci-dessous. Elle fournit élection d’outils et de techniques qui peuvent être utilisés pour générer des données de base sur les attitudes de genre au sein d’une institution du secteur de la sécurité d’un TPCC, et pour mesurer les progrès par rapport à la formation en matière de genre et aux processus de changement institutionnel plus larges. Si les pays contributeurs de troupes s’orientent vers la formation au maintien de la paix en matière de genre pour contribuer à la participation significative des femmes dans les opérations de paix, cette sélection d’outils est un moyen de documenter le succès et (plus important) la manière dont le changement se produit dans les institutions masculines.
Ingrid Munch et Aiko Holvikivi, « Saving the world, one gender training at a time », DCAF, février 2022
Ingrid Munch et Aiko Holvikivi, Saving the world, one gender training at a time, DCAF, février 2022
Cette note d’orientation porte sur la manière dont les pays contributeurs de troupes et de police (TPCC) peuvent tirer parti de la formation en matière de genre, dans le cadre de processus de transformation institutionnelle plus larges, pour renforcer la participation significative des femmes aux opérations de paix et pour développer un maintien de la paix véritablement sensible au genre.
Jake Sherman et Albert Trithart, « Strategic Communications in UN Peace Operations: From an Afterthought to an Operational Necessity », IPI, août 2021.
Jake Sherman et Albert Trithart, "Strategic Communications in UN Peace Operations: From an Afterthought to an Operational Necessity", IPI, août 2021.
Dans cet article, les deux auteurs Jake Sherman et Albert Trithart partent d’un constat : l’utilisation de la communication dans les OP de l’ONU est un outil essentiel pour mener à bien leurs mandats ; en particulier, la nature proactive et stratégique des activités de communication d’aujourd’hui peut être bénéfique à la performance des missions. Cependant, ils mettent en garde contre les risques opérationnels et réputationnels que l’utilisation significative des réseaux sociaux et des smartphones peut entrainer. En effet, ces outils offrent aussi aux groupes armés et autres parties la possibilité de façonner les perceptions du paysage politique, de saper la confiance dans les missions et de mobiliser la violence contre le personnel de l’ONU. Face à ces nouveaux défis, les missions de l’ONU ont renforcé leurs capacités de communication et modifié leur approche. Néanmoins, nombreux sont les chefs de mission qui ne considèrent pas la communication stratégique comme un élément central de la planification et de la prise de décision. La plupart des missions ne disposent pas d’un personnel de communication stratégique possédant les compétences spécialisées et actualisées nécessaires, et il y a un manque général de formation.
Aiko Holvikivi, « Training the Troops on Gender: The Making of a Transnational Practice », International Peacekeeping, janvier 2021
Aiko Holvikivi, "Training the Troops on Gender: The Making of a Transnational Practice", International Peacekeeping, janvier 2021
Dans cet article, Aiko Holvikivi s’intéresse aux différentes approches et enjeux de la formation des forces de maintien de la paix sur les enjeux de genre. Dans cette étude transversale, elle souligne l’importance d’apporter un regard critique sur la littérature existante, en particulier vis-à- vis de la définition du terme « genre » lui-même et de son application au maintien de la paix, éléments très variables et subjectifs selon les instances de formation. L’observation des données empiriques sur la formation confirme en tout cas l’engouement croissant pour cet enjeu, et le soutien politique dont il bénéficie.
Marina Caparini, "Gender training for police peacekeepers: Approaching two decades of United Nations Security Council Resolution 1325", SIPRI, octobre 2019.
Marina Caparini, "Gender training for police peacekeepers: Approaching two decades of United Nations Security Council Resolution 1325", SIPRI, octobre 2019.
L’article souhaite dresser un bilan des 20 ans de la première résolution onusienne portant sur le rôle et la place des femmes dans les domaines de la paix et de la sécurité. Partant de l’angle de la formation policière, l’article souligne les limites de l’approche genrée de la formation pré-déploiement. Il affirme notamment que les nombreux documents d’orientation et de formation de l’ONU n’ont pas permis de mieux comprendre et intégrer la problématique hommes-femmes dans le maintien de la paix, ni d’appréhender la façon d’appliquer une perspective « sexospécifique » au maintien de la paix. Aussi, l’auteure appelle à un meilleur suivi et évaluation post-déploiement, en affirmant que la faiblesse des moyens d’évaluer les formations limite la compréhension de leur efficacité en matière d’égalité des sexes.
« Être acteur des opérations de paix des Nations unies - Le guide pratique des pays contributeurs », Direction générale des Relations internationales et de la Stratégie, 2019.
Document PDF à télécharger
Être acteur des opérations de paix des Nations unies - Le guide pratique des pays contributeurs, 2019.
Ce guide est un véritable mode d’emploi en langue française de la contribution aux missions de la paix. Ce guide, dont l’objectif est d’encourager les pays de l’espace francophone à contribuer plus significativement aux missions de paix, passe en revue les étapes pratiques et les démarches à réaliser pour que l’ONU puisse déployer les militaires et policiers francophones tout en accompagnant les États contributeurs dans une démarche d’amélioration de la performance de leurs unités. Il s’articule autour de six différents chapitres correspondants à l’ensemble des phases d’engagement puis de déploiement d’une OMP : Processus d’inscription d’une offre de contribution dans le système de préparation de capacités de maintien de la paix ; S’inscrire dans la génération de force ; Négocier le Mémorandum d’accord ; S’engager dans le cadre d’un mandat ; Former et préparer un déploiement ; Construire un modèle économique soutenable dans la durée. Plus d’infos ici.
Jefferson Brehm, « The Loss of Arms and Ammunition in Peace Operations: Mapping and Addressing the Challenge », Global Peace Operations Review, juin 2018.
Jefferson Brehm, "The Loss of Arms and Ammunition in Peace Operations: Mapping and Addressing the Challenge", Global Peace Operations Review, juin 2018.
Dans cet article, Jefferson Brehm s’appuie sur les recherche de Small Arms Survey(le lien est externe) (SAS) pour étayer ses propos, et plus particulièrement sur une étude réalisée en octobre 2017 dans le cadre du projet Making Peace Operations More Effective (MPOME) sur les pertes d’armes et de munitions dans les opérations de paix des Nations unies. Il ressort des travaux du SAS que la perte de matériel pendant les opérations de paix est routinière et généralisée. À la suite de plus d’une douzaine de missions entreprises par l’ONU et plusieurs organisations régionales, des milliers d’armes légères et de petit calibre et des millions de munitions sont entrées sur le marché noir. Cet article expose plusieurs aspects de ce phénomène, à commencer par le fait que les pertes de matériel se produisent dans de nombreuses circonstances et ne se limitent pas aux missions dirigées par l’ONU ni même aux déploiements militaires. De plus, les pertes ne résultent pas uniquement d’attaques directes contre les soldats de la paix mais aussi de la corruption et des mauvaises pratiques des forces de maintien de la paix. En effet, si l’ONU a adopté un certain nombre de procédures de sécurité physique et de gestion des stocks (PSSM) d’armes, leur développement et mise en œuvre sont largement délégués aux missions, ce qui fait considérablement varier leur effectivité d’une mission à l’autre, voire d’un contingent à l’autre. Plusieurs facteurs expliquent ces différences dans les pratiques de PSSM pour les installations de stockage d’armements, à savoir le type et la disponibilité des structures de stockage et autres ressources, l’environnement sécuritaire dans lequel les missions opèrent et la nature temporaire de la plupart des opérations de paix. La normalisation et l’uniformisation des pratiques dans l’ensemble des missions résoudraient ainsi un bon nombre des lacunes existantes en matière de sécurité des stocks.
Timothy J.A. Passmore, Megan Shannon et Andrew F. Hart, « Rallying the troops: Collective action and self-interest in UN peacekeeping contributions », Journal of Peace Research, mai 2018.
Timothy J.A. Passmore, Megan Shannon et Andrew F. Hart, "Rallying the troops: Collective action and self-interest in UN peacekeeping contributions", Journal of Peace Research, mai 2018.
Timothy J.A. Passmore, Megan Shannon et Andrew F. Hart s’interrogent sur les facteurs qui favorisent ou empêchent que les missions atteignent la capacité autorisée en personnel dans les mandats. En effet, des ressources insuffisantes peuvent constituer des défis majeurs pour l’efficacité de la mission et menacer la sécurité du pays hôte, voire de la région. Cette étude établit les raisons pour lesquelles les missions échouent à obtenir le nombre de personnel autorisé par le Conseil de sécurité en explorant le rôle du « free-riding » parmi les États membres de l’ONU. Le free-riding peut être compris comme le fait que certains États profitent des bénéfices des opérations de maintien de la paix sans y avoir eux-mêmes contribué. Les auteurs proposent deux solutions à ce phénomène appliqué aux opérations de maintien de la paix. Il faut tout d’abord promouvoir des missions avec un nombre plus restreint d’États contributeurs qui fourniraient un plus grand nombre de personnel, ce qui favoriserait une plus grande implication des pays dans la mission et la responsabilisation des États dans le maintien de la paix. Il faudrait ensuite inciter les États à fournir du personnel en leur proposant des avantages personnels plus directs, notamment en termes économiques, comme par exemple en augmentant la rémunération financière des personnels déployés.
Berman & al, « Making a Tough Job more Difficult: The Loss of Arms and Ammunition in Peace Operations », Small Arms Survey, octobre 2017.
Berman & al, "Making a Tough Job more Difficult: The Loss of Arms and Ammunition in Peace Operations", Small Arms Survey, octobre 2017.
Eric G. Berman, Mihaela Racovita et Matt Schroeder, reviennent sur les pertes d’armements et de munitions qui surviennent lors d’opérations de maintien de la paix, ainsi que sur les efforts menés afin de minimiser l’acquisition non-autorisée et la mauvaise utilisation de ce type de matériel. Ces pertes, qui touchent aussi bien les fusils d’assaut, les pistolets ou même les véhicules blindés, représentent au total des milliers d’armes et des millions de munitions volatilisées. La disparition de ces équipements représente un danger, d’une part pour les troupes engagées dans les opérations de maintien de la paix, d’autre part pour les populations civiles qu’elles sont censées protéger. Qu’elles soient volées, abandonnées sur le terrain ou encore saisies par des groupes armés ou des organisations criminelles, la disparition de ces armes et munitions résulte, la plupart du temps, de la conduite même des opérations de maintien de la paix en zones à hauts risques. Cependant, ce rapport démontre également qu’une quantité considérable d’armements disparait à cause de mauvaises pratiques, de méthodes de surveillance inappropriées ou encore de problèmes de corruption.
Peter Rudolf, « UN Peace Operations and the use of military force », IISS, août 2017.
Peter Rudolf, "UN Peace Operations and the use of military force", IISS, août 2017.
Peter Rudolf est revenu sur la nécessité de trouver un juste milieu dans l’utilisation de la force dans les opérations de maintien de la paix. Peter Rudolf rappelle que ces dernières années, le caractère varié des terrains d’intervention et la diversification des menaces ont amené les OMP à se militariser et a de plus en plus utiliser la force dans le cadre de leur mandat. La dimension « contre-insurrectionnelle » de certaines OMP, comme la MONUSCO ou la MINUSMA, a établi un flou autour de la frontière entre le maintien de la paix et « l’application de la paix ».
« Guide de la génération de force », Ministère de la Défense français (DGRIS), octobre 2016.
Peter Rudolf, "UN Peace Operations and the use of military force", IISS, août 2017.
Ce guide, rédigé par le ministère de la Défense français, est destiné aux États candidats à une contribution militaire ou policière aux Opérations de maintien de la paix (OMP) des Nations unies. Il leur détaille la procédure de génération de force de l’Organisation des Nations unies (ONU).