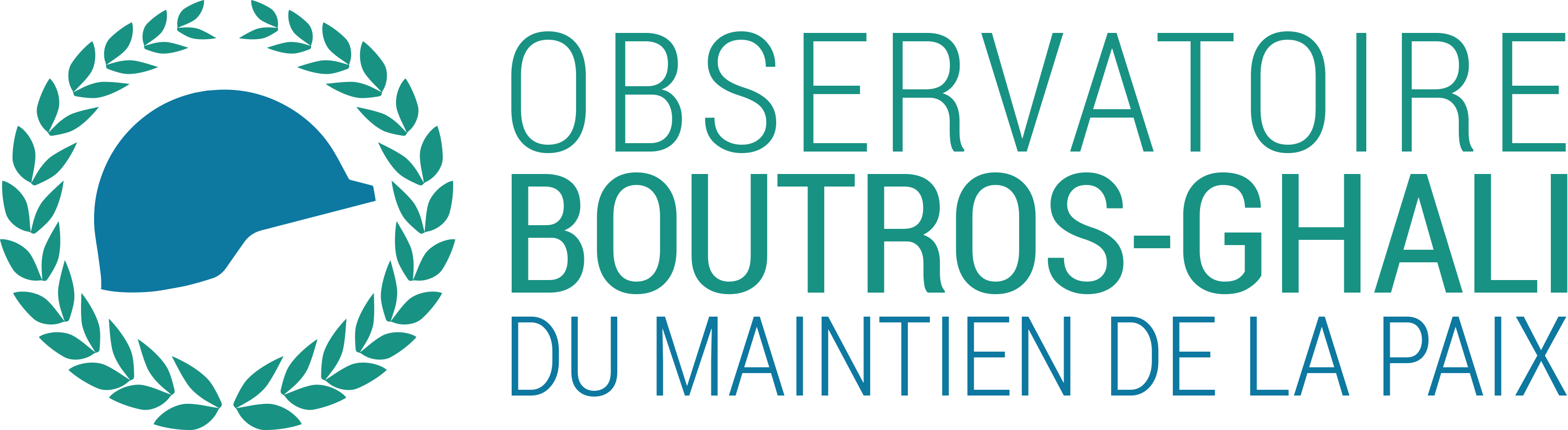L’Observatoire Boutros-Ghali (OBG) du maintien de la paix, en partenariat avec la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie (DGRIS) du ministère des Armées français et avec le soutien de la Mission permanente du Sénégal auprès des Nations unies et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a organisé un séminaire intitulé « Les enjeux de la francophonie dans le maintien de la paix – État des lieux et perspectives sur l’engagement des pays contributeurs de troupes et de police francophones dans les opérations de paix » (PCT/P).
Cet évènement s’est déroulé le 20 novembre au siège des Nations unies, à New York. Les échanges ont été en partie filmés et retransmis en direct sur UN Web TV. Afin de faciliter l’appropriation de ces sujets par un auditoire francophone, cette activité était intégralement proposée en langue française.
Ce nouvel évènement entendait nourrir les réflexions relatives au rôle de la francophonie dans le maintien de la paix, au regard des importantes évolutions connues par les opérations de paix (OP) depuis plusieurs années. Structurés autour de trois panels, les échanges avaient pour objectif de faire émerger des pistes d’action et des recommandations concrètes pour promouvoir l’utilisation de la langue française (y compris par des pays non francophones), et pour améliorer davantage les capacités ainsi que la contribution des PCT/P francophones, tant au siège des Nations unies que sur le terrain.
Dans un premier temps, l’intervention liminaire, assurée par Khaled Khiari, Sous-Secrétaire général pour le Moyen-Orient, l’Asie et le Pacifique, Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix – Département des opérations de paix, a porté sur le rôle, la contribution et l’avenir de la francophonie dans le maintien de la paix. Le Général Birame Diop, ministre des Forces armées du Sénégal, a assuré le rôle de répondant à cette intervention.
Ensuite, lors du premier panel, nous avons abordé les enjeux politiques et institutionnels francophones du maintien de la paix. Dans un second panel, les intervenants ont discuté des défis opérationnels des missions onusiennes en zone francophones auxquels font face les PCT/P. Enfin, une table ronde, non retransmise, a conclu cette journée de réflexion et a permis de mettre en avant les nouvelles initiatives francophones dans le maintien de la paix afin de renforcer la contribution dans le maintien de la paix des acteurs francophones . Elle fut l’occasion de revenir sur les opportunités et défis de coopération, de coordination et de mise en cohérence de ces différentes initiatives.
Voir le synopsis et programme complet

Introduction

Les différents partenaires de cet évènement ont initié la journée par quelques mots introductifs. Au nom du Sénégal, l’Ambassadeur Cheikh Niang, Représentant permanent auprès des Nations unies, a souligné le « potentiel extraordinaire » présent en l’espace francophone et qui peut être mis au service de la promotion de la paix et de la stabilité dans le monde.
Mme l’Ambassadeur Ifigeneia Kontoleontos, Observatrice permanente de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) auprès des Nations unies, a pour sa part rappelé que le maintien de la paix est à la croisée des chemins, d’où la pertinence de débats et de réflexion sur cet outil en pleine transformation parmi les acteurs francophones.
Le Contre-amiral Ludovic Poitou, Chef du Service des affaires de sécurité internationale, Direction générale des relations internationales et stratégiques (DGRIS) du ministère des Armées français, s’est inquiété des obstacles persistants auxquels font face les pays contributeurs de troupes et de police francophones dans leur engagement dans le maintien de la paix onusien.
Solène Jomier, coordinatrice de l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix, a insisté sur les objectifs de cette journée de discussion, visant à faire un état des lieux de l’engagement des PCT/P francophones, des défis qu’ils rencontrent à la fois au siège à New York et sur le terrain de missions, et sur les perspectives futures de leur implication dans cet outil onusien.
Intervention principale – « Rôle, contribution et avenir de la francophonie dans le maintien de la paix »

Voir la Vidéo (à partir de 22:40)
L’intervention introductive, animée par Khaled Khiari, Sous-secrétaire général chargé du Moyen-Orient, de l’Asie et du Pacifique au sein des Départements des affaires politiques, de la consolidation de la paix et des opérations de paix, s’est focalisée sur le rôle, les contributions et les perspectives d’avenir de la francophonie dans le domaine du maintien de la paix.
Dans son intervention, le Sous-secrétaire est revenu sur les évolutions des conflits et de la réponse que l’ONU y apporte. Cette dernière implique des ajustements aussi au niveau des PCT/P, entre autres avec une meilleure préparation opérationnelle en amont du déploiement et des investissements nécessaires en matière de formation des troupes.
Dans cette équation, il a rappelé que la maitrise de la langue est un facteur clé de la réussite des opérations de paix. Elle participe notamment de l’instauration de la confiance entre les forces de la mission et la population locale. Reste que cette maitrise doit aussi s’accompagner d’une compétence technique souvent pointue, et pourtant essentielle à la réussite du travail de la mission. À ce sujet, Khaled Khiari a fait remarquer le rôle clé joué par les experts militaires francophones à la MINUSCA.
Si cette expertise est éminemment utile, le continent africain, et à travers lui le continent africain francophone, manque de ressources pour répondre aux nouveaux défis du maintien de la paix. Monsieur Khiari met en avant les efforts de l’ONU pour combler ces lacunes, avec en particulier les efforts engagés au travers du Mécanisme souple de coordination (LCM).
Pour conclure, il a identifié 3 axes de travail et de réflexion pour les acteurs francophones du maintien de la paix :
- Améliorer la participation au maintien de la paix des PCT/P francophones en soutenant une vision stratégique francophone;
- Accroitre l’usage de la langue française dans les OP en favorisant aussi l’apprentissage du français auprès du personnel non francophone amené à être déployé ;
- Renforcer les capacités techniques du personnel francophone.
Réagissant à cette intervention introductive, le Général Birame Diop, ministre des Forces armées du Sénégal, a appelé la salle à s’interroger sur le rôle politique et le cadre politique à une voix francophone dans le maintien de la paix. Il a défendu sa position en faveur de plus de prévention via l’amélioration de la bonne gouvernance, le soutien aux processus de démocratisation afin de garantir une paix durable. S’agissant des missions de paix de l’ONU, il a insisté sur l’importance d’établir des mandats pertinents, en adéquation avec les problématiques locales. Une meilleure coordination des acteurs francophones est nécessaire à ce niveau, afin de se faire la voix d’une telle garantie. Khaled Khiari a complété en insistant sur l’importance de donner la primauté aux solutions politiques aux conflits.
Panel 1 – Enjeux politiques et institutionnels francophones du maintien de la paix

Voir la Vidéo (à partir de 1:38:30)
Le premier panel a réuni 3 intervenants et intervenantes, a été modéré par Solène Jomier, coordinatrice de l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix.
L’ambassadeur Ghislain Ondias Okouma, Représentant permanent de la République du Gabon auprès des Nations unies, a partagé l’expérience de son pays qui a été co-porteur de plume, aux côtés du Mozambique et du Ghana, de la résolution 2719 (2023) portant sur le soutien de l’ONU à des opérations de soutien à la paix. Si l’équipe de la mission gabonaise avait à cœur de faire prévaloir le compromis, elle a rencontré des obstacles très concrets dans la mise en œuvre de ce rôle. La charge de travail supplémentaire associée, portée par une équipe limitée dans son nombre et dans ses ressources, a exigé une montée en compétence pointilleuse (aspects techniques, juridiques et politiques à la fois) et a fait peser une pression importante sur le personnel. Au-delà, l’omniprésence de la langue anglaise dans les négociations de couloir a été un frein à sa capacité à faire porter sa voix, à débattre sur des enjeux techniques en amont de l’établissement du texte final.
Pour Mme Isis Jaraud Darnault, coordinatrice politique au sein de la Représentation permanente de la France auprès des Nations unies, cet enjeu de la langue de travail est aussi un point d’attention. Elle souligne que même lorsque le pays-hôte de la mission est francophone, les négociations sur le mandat se font en anglais. Cela apporte une lenteur problématique à de nombreux niveaux, et notamment en matière de traduction puisque certains textes ne sont traduits que trop tardivement dans la langue de l’État hôte, ce qui peut être instrumentalisé par les acteurs de la désinformation. Cette primauté de la langue anglaise comme langue de travail n’est d’ailleurs pas toujours cohérente avec les appuis financiers apportés par les uns et les autres. Le support linguistique adéquat est pourtant un garant de la bonne relation avec l’État hôte d’une mission, ou bien encore de la bonne appropriation des formations en amont du déploiement.
Concluant le panel, Arthur Boutellis, chercheur associé à l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix, fait état de manière plus transversale du potentiel pour l’heure non réalisé d’une voix francophone dans le maintien de la paix. La francophonie reste une plateforme parmi tant d’autres pour faire porter la voix d’un État à l’ONU et sur les enjeux de paix. Cette « première ONU », celle des États, reste donc un espace où les francophones ne sont pas un groupe particulièrement structuré, quoique des efforts ont lieu en ce sens. Au niveau de la « deuxième ONU », celle du secrétariat et du personnel des missions, le nombre de locuteurs francophones est en progression, et la langue française est aussi désormais un support de formation du DAO. Il appelle à renforcer les liens entre ces deux piliers et la « troisième ONU », celle des think tanks, fondations et autres acteurs de la société civile.
La session de question/réponses avec la salle et les échanges avec la modération ont été l’occasion d’évoquer également l’importance de soutenir le multilinguisme à l’ONU, d’accompagner la montée en compétence des acteurs institutionnels francophones notamment via une meilleure circulation des ressources de fond, et sur le rôle de l’organisation internationale de la Francophonie dans cette équation.
Panel 2 – Les PCT/P face aux défis opérationnels des Missions en zone francophone

Le deuxième panel a réuni 3 intervenants et intervenantes, a été modéré par Arthur Boutellis, chercheur associé à l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix.
Le Général Jean-Paul Deconinck, ancien Commandant de la Force de la MINUSMA (2017 – 2018), a estimé que la mission au Mali n’a pas été l’échec que l’on dépeint, elle a su agir pour ralentir la spirale négative, même si elle restait un outil pas tout à fait adapté à la mission initialement entrevue. Pour autant, il estime qu’il faut réinsuffler l’enthousiasme au cœur du maintien de la paix, à travers notamment la démonstration plus claire et concrète des bénéfices, et notamment de l’utilité de la maitrise du français. Il souligne son expérience à la MINUSMA où les PCT/P francophones ont pu créer des relations de confiance avec certaines populations, soulignant l’importance de la connaissance du milieu et de l’interaction humaine dans ce type de mission. Les efforts de l’ONU et des PCT/P doivent se concentrer sur la réduction des freins via un mandat réaliste, une meilleure intégration, et une approche non pas « cost-driven » (structurée par le financier), mais « effect-driven » (structurée par l’impact réel visé).
Naomi Miyashita, responsable de la gestion du projet pour lutter contre la désinformation au sein du Département des opérations de paix, a rebondi sur l’importance d’établir la confiance et d’agir au niveau préventif face aux défis de la désinformation, qui sont une menace majeure pour les missions. La MINUSMA a été une opération marquante sur cet aspect, avec une capacité à construire une confiance durable avec certains acteurs. Ailleurs, la maitrise du français participe aussi en RCA et RDC d’une meilleure compréhension à la fois verbale, mais plus largement d’une sensibilité au contexte culturel et historique. C’est un travail de longue haleine, bien au-delà de la seule maitrise de nouveaux outils technologiques. La communication, à la fois entre les composantes des missions, et avec les acteurs locaux, est essentielle pour garantir une lutte efficace contre la désinformation. Elle encourage les PCT/P à mieux préparer les troupes à ces enjeux lors de la préparation pré-déploiement.
Enfin, Ahmed Sameh, Directeur adjoint du Centre international du Caire pour la résolution de conflits, le maintien et la consolidation de la paix (CCCPA), est revenu sur les défis rencontrés par son centre de formation. Il a rappelé ses efforts de son centre afin d’accroitre la maitrise de la langue française parmi les Casques bleus égyptiens, avec l’objectif ouvertement annoncé de faciliter leur déploiement en espace francophone. Il s’agit à la fois de faciliter la communication entre troupes francophones, avec les populations et avec l’État hôte. Le centre a notamment développé une nouvelle formation « climat, paix, sécurité » en français, à destination des autres PCT/P francophones. Ahmed Sameh appelle à renforcer la coopération entre les centres de formation francophones au service du renforcement des capacités.
La session de question/réponses avec la salle et les échanges avec la modération ont conduit à échanger également sur les défis de la communication stratégique, la formation des formateurs, et les efforts en matière d’intégration.
Table ronde – Les PCT/P face aux défis opérationnels des Missions en zone francophone

La journée de rencontre s’est poursuivie par une table ronde modérée par Clémence Buchet-Couzy, en présence de Général de brigade Vincent de Kytspotter, Chef de la Représentation militaire et de Défense de la France aux Nations unies, Grégory Robert, Spécialiste de programme – Maintien et consolidation de la paix au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et Ettore Di Benedetto, Chef d’équipe au sein du Service intégré de formation du Département des opérations de paix (DOP).
Cet échange n’était pas enregistré. Il fait l’objet d’un résumé plus complet sur la page dédiée.
Conclusion
Solène Jomier, coordinatrice de l’Observatoire Boutros-Ghali a conclu les échanges de cette journée en proposant quelques réflexions transversales. Elle constate que la francophonie est avant tout un « potentiel » de coopération, qui pourrait à l’avenir avoir une « voix commune » au chapitre. Cependant, ce potentiel reste à mettre en œuvre, à la fois :
- sur des aspects politiques, avec plus de coopération au niveau des représentations diplomatiques à New York, visant à favoriser le partage d’information, la transmission de compétence et le retour d’expérience, mais aussi à promouvoir l’usage du français en tant que langue de travail et support de traduction plus systématique ;
- sur des aspects opérationnels, au service de missions mieux outillées pour construire la confiance avec les populations (sensibilité interculturelle, multilinguisme), à travers notamment le renforcement des partenariats entre les acteurs de la formation, la mise en place de formations en français et le partage des bonnes pratiques.
Reste que ces engagements doivent pouvoir s’inscrire dans une action collective coordonnée, au service d’un projet cohérent, et au cœur d’un travail projeté sur des temps longs et avec une approche durable.
La fin de cette journée a été marquée par un cocktail de clôture offert par l’Organisation internationale de la Francophonie.
L’équipe de l’Observatoire a également participé, le lendemain, à un atelier de haut niveau portant sur la stratégie nationale des PCT/P. En savoir plus.
crédits photo : GRIP/Obs Boutros-Ghali